|
(Dessin réalisé au primaire) Contactez-moi : cejean@charleries.net |
Les charleries Bienvenue sur mon blogue, Ce blogue contient des souvenirs, des anecdotes, des opinions, de la fiction, des bribes d’histoire, des récréations et des documents d’archives. Charles-É. Jean
|
|
Séminaire de Rimouski |
|
|
# 6705
12 janvier 2023
Le Père Charles
Quand
j’étudiais au Séminaire de Rimouski de 1953 à 1961, il y avait trois
personnages remarquables, autres que les prêtres, qui avaient déjà
consacré de nombreuses années au service du Séminaire : Sœur Pauline
à la cuisine, Pierre Sellier, portier et le père Picard, concierge.
Avant eux, il fut un personnage très remarqué qui entra en fonction
comme serviteur en 1869 jusqu’à sa mort en 1910. Les autorités du
Séminaire ont alors cru bon de faire ses éloges dans un article de
journal publié dans le Progrès du Golfe, le 11 mars 1910.
L’article est signé par le chanoine Fortunat Charron qui est alors
préfet des études. En voici de larges extraits :
« Le Père
Charles est mort ! Tous les citoyens de Rimouski et les anciens
élèves du Séminaire de cette ville savent de qui je veux parler. Si
j’avais appelé le défunt par son nom véritable, Charles Caron,
personne n’aurait compris qui je voulais désigner : mais j'ai nommé
le Père Charles et tous apprennent avec regret la mort du bon vieux
serviteur du Séminaire. Le Père Charles ! C’est à bon droit que tout
le monde lui donnait ce surnom affectueux. Il était en quelque sorte
le père des deux ou trois générations qui ont reçu leur éducation au
Séminaire de Rimouski.
Il entrait au
collège, en qualité de serviteur, il y a 43 ans, à la date exacte du
27 août 1867. Le Séminaire actuel n’existait pas encore : loin de là
! Celui que détruisait l’incendie du mois d’avril 1881 n’avait pas
encore été commencé ; le diocèse venait à peine d'être érigé et le
premier évêque n’avait pris possession de son siège que depuis trois
mois.
Si l’on se
rappelle que Mgr Langevin occupa pendant 23 ans le siège épiscopal
et que son digne successeur a déjà fourni une laborieuse carrière de
20 ans d’épiscopat, on s’imaginera plus facilement le nombre
d’années passées par le défunt au Séminaire. Quinze ans, disait le
poète long espace pour une vie humaine ! Le Père Charles a triplé ce
long espace. Il l’a triplé en demeurant toujours le même, alors que
tout changeait autour de lui. (…)
En 50 ans,
quatre fois et plus se changea le toit sous lequel dormait toute la
communauté, alors que, tout autour, les toits rouges et gris de
Rimouski ne semblaient pas vieillir. Le Père Charles seul demeura.
Il connut les écoliers de 1867 « ceux qui penchent vers la tombe et
dont les fils sont vieux » et ceux de toutes les classes
successives, jusqu’à celles de l'an de grâce 1910. Jusqu’à ces
dernières années, il savait les noms des premiers et des derniers,
leur lieu d'origine, leur profession, souvent ; il les reconnaissait
au retour, et c'est avec une joie et une émotion vraiment paternelle
qu’il les voyait revenir après dix ou vingt ans sous le toit
hospitalier de l’Alma Mater. Il remarquait qu’ils avaient grandi,
qu’ils avaient changé de figure et il se surprenait à penser, le
Père Charles, qu’il avait encore vieilli de dix ou de vingt ans.
Le Père
Charles du Séminaire (c’était un titre de noblesse qu’il avait
coutume de se donner) était la personnification du serviteur en tout
point semblable à ceux à qui l’Académie Française décerne chaque
année des prix de vertu, serviteur inamovible, fidèle, dévoué,
attaché à ses maîtres et aux élèves quels qu’ils fussent. Il était
encore la personnification de la piété et de la solide vertu. Les
moments de liberté que lui laissaient ses occupations, il les
passait en prière ou en méditation. Ceux qui ont étudié dans le
Séminaire actuel se rappelle du petit parloir des prêtres, situé
près de l’entrée principale. C’est là surtout que le Père Charles
s’est sanctifié, dans la récitation de ses rosaires ou dans ses
lectures pieuses.
La vieille
chapelle était à proximité. Il y passait des heures, absorbé dans
l’adoration du Très Saint Sacrement et dans la prière pour les
pécheurs. Aussi bien, était-il parvenu, grâce à cette pratique
assidue des choses de Dieu, à un état de perfection peu commune, qui
le faisait vénérer comme un saint par les écoliers naturellement
gouailleurs. Cette piété ne se démentait pas ; elle n’avait ni
hausse, ni baisse. Pour elle point de vacances. Pendant les jours
ensoleillés de l’été, quand chacun obéit aux suggestions du repos et
d’une délicieuse langueur, le Père Charles priait dans son parloir,
dans la chapelle, ou sur le balcon, ou encore relisait pour la
centième et la millième fois les chapitres pieux de son « Ange
Conducteur ». Ou bien, on le voyait, à la tombée du jour, se
promenant à pas lents, le long du jeu de balle, tout en égrenant un
chapelet usé par les ans et les doigts.
Pendant ses
dernières années, il avait choisi la sacristie de la nouvelle
chapelle comme oratoire et ainsi que dans l’ancienne, et plus
peut-être, vu que ses heures n’étaient pas prises par le service de
la maison, il adorait, il priait. (…)
La vertu du
Père Charles se traduisait au dehors par une grande simplicité, par
une grande charité envers les pauvres, par une honnêteté à toute
épreuve, par une douceur jamais prise en défaut, par … je nommerais
ici toutes les vertus. On rapporte pourtant qu’un élève entendit un
jour un gros mot sur ses lèvres. Le Père riait souvent et méditait à
voix haute, quand il pensait ne pas être entendu. Comme cet élève se
trouvait à la chapelle sans que le Père Charles l’eût remarqué, il
donnait libre cours à son oraison. Tout-à-coup le bon étudiant est
stupéfait d’entendre cette grave parole : « Maudit ............
maudit péché ». (…)
Le Père
Charles est mort sans bruit, comme il avait vécu. Depuis dimanche,
le 6 mars, il était un peu malade, mais rien ne faisait prévoir une
fin aussi prochaine. La veille de sa mort, il descendait même au
réfectoire pour le souper. Le mercredi, 9 mars au matin, le
Supérieur, qui allait le visiter, le trouva renversé sur son lit. Il
s’était levé, s’était habillé lui-même, puis … la fin était venue.
Le bon Dieu l’avait appelé dans son paradis.
Grâce à une
épidémie de variole qui désolait le Séminaire les autorités ne
purent lui rendre tous les honneurs qu’ils auraient voulu et
auxquels il avait droit ; ils ont cependant désiré que la vertu du
défunt fut publiée, et c’est avec leur approbation que ces lignes
écrites à la hâte et qui rendent bien imparfaitement notre pensée
sont livrées au public. Ils estiment avec l’Écriture que l’homme
prudent et fidèle doit être loué beaucoup. »
Fortunat
Charron
P. S. Ceci est le 200e article que j'ai publié dans ce blogue sur le Séminaire de Rimouski. Ceci est également le dernier article considérant que j’ai visité à peu près toutes les sources qui sont présentes aujourd’hui sur la toile. |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6685
30 décembre 2022
Un deuil
douloureux
Le Progrès
du Golfe, dans son édition du 25 janvier 1929, rapporte un
événement qui a secoué la grande famille du Séminaire de Rimouski :
« Vendredi
dernier, le 18 janvier, décédait à l’hôpital de Rimouski, un jeune
écolier du Séminaire, Jean-Charles Pelletier, âgé de 15 ans et 6
mois, élève de Syntaxe-latine.
Revenu au
Séminaire après les vacances depuis quatre jours seulement, le jeune
écolier semblait plein de santé malgré certains maux de tête
passagers, quand dans la nuit du 12 au 13, il fut subitement atteint
d’une méningite aigue qui le conduisit au tombeau après six jours de
maladie.
Cette mort
soudaine produisit, il va sans dire, une tristesse et une douleur
générale dans notre Maison. Depuis 1905, on n’avait pas eu encore à
déplorer une semblable perte. Pendant la maladie de Jean-Charles,
des visites assidues lui furent rendues ; tout le monde
s’intéressait au petit malade ; on pria et on fit prier pour lui ;
on fit tout pour le sauver de la mort. Mais Dieu le voulait dans sa
gloire et n’exauça pas nos prières. Dieu avait décidé de l’appeler à
lui dans sa tendre jeunesse. (…)
Quelques
heures après sa mort, le corps du jeune élève revenait sous le toit
protecteur de son Alma Mater qui l’avait abrité pendant une année et
demie. On l’exposa en chapelle ardente toute la soirée et toute la
nuit. La communauté entière, directeurs et professeurs, confrères et
amis vinrent tour à tour défiler devant lui et prier à ses côtés,
contempler dans son sommeil paisible sa figure encore souriante, et
aussi pleurer cet enfant que la grande famille du Séminaire perdait.
Tous garderont à jamais le souvenir de leur petit frère Jean-Charles
dormant son dernier sommeil dans le petit salon d’en bas …
Le lendemain,
samedi à 6 h, un service fut chanté par M. le Supérieur, en la
chapelle du Séminaire. Son père, le cœur brisé de douleur, y
assistait à côté du corps de son cher fils. Tous communièrent pour
le cher défunt. Que d’émotions en une circonstance pareille ! Qui
eut pensé, une semaine auparavant, que ce petit écolier plein de vie
serait ce matin-là, couché dans un cercueil en avant de la chapelle,
et entouré de ses confrères qui chantent, le cœur gros et les yeux
pleins de larmes, le chant funèbre de la messe des morts.
Après le
service, la communauté alla en silence reconduire le cher disparu à
la gare, où quelques minutes après, un train emportait pour
toujours, loin de nos regards, ce qui avait été Jean-Charles … Mais
son souvenir est resté parmi nous … et y vivra longtemps.
Lundi, le 21,
en l’église de St-François-Xavier de la Rivière-du-Loup, eurent lieu
les funérailles du petit Jean-Charles Pelletier, au milieu d’un
concours de prêtres, de parents et d’amis. Le service fut chanté par
M. l’abbé L. D’Anjou, directeur du Séminaire de Rimouski, assisté de
MM. les abbés Moreau et Paris, vicaires, comme diacre et
sous-diacre. Aux autels latéraux des messes furent dites par MM. les
abbés Émile St-Pierre et André-Albert Dechamplain du Séminaire.
(…) » (Fin du texte cité |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6670
21 décembre 2022
Nouvelles brèves (1935-1966)
En faisant des recherches dans les journaux québécois, j’ai trouvé
des éléments d’information sur le Séminaire de Rimouski qui ont un
certain intérêt. Voici quelques-uns de ces éléments pour la période
donnée :
1935 - La distribution des prix aux élèves du Séminaire de Rimouski
a eu lieu hier après-midi (13 juin) à 3 heures sous la présidence du
Supérieur, M. le chanoine Lionel Roy. Le discours des anciens fut
prononcé par M. le magistrat H.-R. Fiset de Rivière-du-Loup. Celui
des finissants par M. Louis-Philippe Saintonge. Ils sont cette année
28 finissants. M. le Supérieur clôtura la séance par une allocution
suivie du chant du Te Deum à la chapelle. La sortie eut lieu
immédiatement. Seuls sont restés, les physiciens et les rhétoriciens
qui subissent les examens du baccalauréat. (Progrès du
Golfe, 14 juin 1935)
1945 -
Fondation du Cercle Lacordaire au Séminaire.
1950 - L’Annuaire nous révèle que, pour l’année 1949-1950, le nombre
total des élèves a été de 1138 répartis comme suit : Grand
Séminaire : 61, Petit Séminaire : 511, École de Commerce : 186,
École d’Agriculture : 66, École Technique : 247, École de Marine :
67. (Progrès du Golfe, 30
juin 1950)
1956 - Les citoyens de Rimouski « entendent » maintenant sonner les
heures, du clocher du Séminaire. En effet, l’horloge électrique
qu’on vient d’installer sur cet édifice indique aux citadins, le
jour et la nuit (des projecteurs éclairent le soir son triple
cadran) l’heure exacte, et cela à quelque endroit qu'ils se trouvent
dans Ia ville. Qu’ils la voient ou qu’ils l’entendent, l'horloge du
Séminaire est une « commodité » bien sympathique pour les gens de
Rimouski. (Progrès du Golfe,
1er juin 1956)
1959 - Le Progrès du Golfe publie la mosaïque des
Rhétoriciens 1958-1959 du Séminaire de Rimouski, soit ceux du 98e
cours. (Progrès du Golfe,
3 avril 1959)
1960 - Le Progrès du Golfe publie la mosaïque des
Rhétoriciens 1959-1960 du Séminaire de Rimouski. Un journaliste de
cet hebdo régional la qualifie de « belle horreur ». (Progrès
du Golfe, 11 mars 1960)
1961 - Pour la deuxième année consécutive, le Séminaire de Rimouski
décroche le Prix du Prince de Galles tant convoité par les
finissants en Philosophie II. C’est M. Paul-Émile Vignola, de
St-Fabien, qui s’est mérité, cette année, le Prix du Prince de
Galles, ayant conservé 130,8 points sur un total de 140. Il est le
fils de M. et Mme Philippe Vignola. L’an dernier, c’est M. Jean-Yves
Thériault, de St-Octave, finissant du Séminaire de Rimouski, qui se
méritait cet honneur, en conservant 130,9 points. (Progrès
du Golfe, 30 juin 1961)
1961 - On apprend que 53 étudiants du Séminaire de Rimouski ont été
honorés du titre de bachelier ès arts par l’Université Laval. Ce
titre est décerné aux Finissants qui ont réussi les examens
universitaires. Les examens universitaires étaient les suivants :
Apologétique sur 20, Logique et philosophie naturelle sur 15, Chimie
sur 20, Dissertation sur 20, Morale et métaphysique sur 25, Physique
sur 20, Mathématiques sur 20, pour un total de 140. Les trois
premiers examens avaient été passés en Philo I. Outre les noms des
finissants qui ont réussi, on trouve les noms des étudiants de
Rhétorique et de Versification. (Progrès
du Golfe, 30 juin 1961)
1964 - Le conseil de la ville de Rimouski rendra publiquement
hommage à MM. Claude Mongrain, Charles Lindsay, Jean Bérubé et Guy
Turcotte, les brillants étudiants du Petit Séminaire qui nous ont
fait honneur, à nous de Rimouski et à toute la région, au programme
télévisé F = MA. Une bourse sera remise à chacun d’eux, par Son
Honneur le Maire, en présence du Supérieur du Séminaire, de leurs
professeurs et de toute la population, au cours d’une séance
spéciale qui aura lieu à l’hôtel de ville le 22 juin.( Progrès du
Golfe, 19 juin 1964)
1966 - L’Université Laval vient de reconnaître comme bacheliers les étudiants qui ont terminé leur cours Collégial au Séminaire de Rimouski à la fin de mai dernier. Ces étudiants devaient réussir les examens donnés par le Séminaire même. Nous notons que c’est la première fois qu’un tel système était appliqué intégralement. Les questionnaires d’examens provenaient autrefois de l’université Laval. (Progrès du Golfe, 28 juillet 1966) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6655
12 décembre 2022
Nouvelles brèves (1919-1934)
En faisant des recherches dans les journaux québécois, j’ai trouvé
des éléments d’information sur le Séminaire de Rimouski qui ont un
certain intérêt. Voici quelques-uns de ces éléments pour la période
donnée :
1919 – « La distribution solennelle des prix a eu lieu hier soir
devant une foule de spectateurs. Il y eut chant et musique par les
élèves. M. le supérieur termina la séance par une éloquente
allocution. La rentrée des élèves est fixée au 5 septembre. » (Progrès
du Golfe, 20 juin 1919)
1920 – Le Supérieur Fortunat Charron invite tous les anciens élèves
et professeurs du Séminaire de Rimouski à participer à un conventum
les 22 et 23 juin prochain. L’invitation s’adresse à tous les élèves
autant du cours commercial que du cours classique.
(Progrès du Golfe, 1er mai 1920)
1923 - On apprend que 14 bacheliers sur 21 candidats ont réussi les examens
universitaires en Physique et que 8 bacheliers sur 15 ont réussi en
Rhétorique. (Progrès
du Golfe, 29 juin 1923)
1925 - L’inauguration officielle et la
bénédiction solennelle du nouveau Séminaire de Rimouski ont eu lieu
les 3 et 4 novembre. Elles ont donné lieu à des cérémonies
mémorables et d’une grande splendeur. On comptait sur la présence de
sept évêques, de nombreux dignitaires autant ecclésiastiques que
civils et d’une foule d’anciens élèves. Entre autres, quatre
allocutions furent prononcées par autant de personnalités : M. le
chanoine Moreault, supérieur du Séminaire, Mgr Camille Roy, recteur
de l’Université Laval, supérieur du Séminaire de Québec, et écrivain
de renom, M. Elzéar Sasseville, C R., de Rimouski, l’un des anciens
élèves les plus brillants de notre Séminaire, et Mgr J.-R. Léonard,
évêque de Rimouski, ancien élève et ancien directeur de la maison. (Progrès du
Golfe, 6 novembre 1925)
1926 – « Nous annoncions vendredi dernier le beau succès d’un élève
du Séminaire, M. Philippe Blais, de cette ville, au récent concours
universitaire dit du Prince de Galles. Le jour même de la
distribution des prix, le Séminaire était avisé par l’Université que
le même élève remportait le PREMIER prix Casgrain, au concours
universitaire d’histoire du Canada. Ce prix l’une valeur de trente
piastres, est le plus important (si l’on tient compte de la somme
d’argent ainsi gagnée) de l’Université. On sait qu’il fut fondé par
l’honorable Tom-Chase Casgrain quelques années avant sa mort.
L’annuaire du Séminaire, que nous avons justement sous les yeux,
note que le Séminaire a remporté QUATRE fois l’un de ces prix (car
il y en a deux : trente et vingt piastres), deux fois le premier et
deux fois le second, depuis sa fondation, il y a une dizaine
d’années. » (Progrès du Golfe,
25 juin 1926)
1928 – Selon le Progrès du
Golfe du 21 décembre 1928, « les élèves ont eu congé mercredi 19
décembre à cause d’une épidémie de grippe. » Au début du Séminaire,
les élèves n’avaient aucun congé. Ils entraient en septembre et
quittaient en juin pour les vacances d’été. Plus tard, un congé du
Jour de l’an fut ajouté. Il commençait le 30 ou le 31 décembre. Pour
la première année, en 1928, les élèves ont congé à Noël. Deux ans
après l’événement, les vacances des Fêtes commencent autour du 23
décembre. Un congé à Pâques fut ajouté dans les années 1930 et à la
Toussaint en 1954.
1931 – « Le Séminaire de Rimouski remporte cette année le prix du
Prince de Galles en Philosophie senior. Gérard Fillion, l’un des
plus brillants élèves de ce collège, a été proclamé vainqueur, hier
soir, par Mgr Philéas Fillion, P. A., recteur de l’Université Laval,
à la fin de la séance publique du concours oratoire provincial. Mgr
Fillion a félicité le supérieur du Séminaire de Rimouski, M. le
chanoine Charron, qui assistait à la séance. » (Le
Soleil, 3 juin 1931)
1934 – « Académie St-Jean l’Évangéliste. Les Académiciens
consacrent leur séance publique du 5 juin à la glorification de
Jacques Cartier. » (Progrès du
Golfe, 8 juin 1934)
1934 - Une nouvelle association nationale de bienfaisance vient de prendre naissance dans notre région ; c’est l'association des Amis du Séminaire de Rimouski dont le siège social est à Rimouski même. Le but de cette association est de promouvoir la cause de l’éducation telle que servie par le Séminaire de Rimouski. À cette fin, l’association tend à recueillir les sympathies non seulement des anciens élèves du Séminaire de Rimouski déjà membres de l’Amicale, mais aussi de tous les amis de l’éducation auxquels des cartes de membres seront remises leur conférant tous les droits et privilèges de l’association. L’échevin Martin Lepage est nommé président, M. le docteur Pierre-Paul Gagnon, vice-président, M. l’abbé Antoine Gagnon, secrétaire, M. le chanoine Flavius D’Anjou, trésorier. (Progrès du Golfe 22 juin 1934) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6635
30 novembre 2022
Nouvelles brèves (1886-1918)
En faisant des recherches dans les journaux québécois, j’ai trouvé
des éléments d’information sur le Séminaire de Rimouski qui ont un
certain intérêt. Voici quelques-uns de ces éléments pour la période
donnée :
1886 – Le journal La Justice nous apprend que le révérend
Georges Potvin a fait don de sa bibliothèque au Séminaire de
Rimouski. (13 février 1886)
1886 - Dans un article signé
par Z dans le journal La justice, l’auteur met en doute le
fait que le révérend Georges Potvin soit le fondateur du collège
classique de Rimouski. Toutefois, il admet que M. Potvin a beaucoup
travaillé pour le Séminaire. Il suggère le nom du révérend M. Elzéar
Couture. Il nomme aussi Mgr Jean Langevin. Mais, il réfute cette
dernière proposition en citant des écrits de l’évêque lui-même. Pour
Z, le véritable fondateur est le révérend Cyprien Tanguay qui a été
curé de Rimouski de 1850 à 1859. (16 février 1886)
1888 – En ce 18 mars, le club
St-Patrick du Séminaire de Rimouski présente un spectacle fort
réussi auquel assistent Mgr Jean Langevin et d’autres dignitaires
ecclésiastiques. Selon l’auteur de l’article, le discours
d'ouverture prononcé par M. George Colclough, élève de Physique, est
digne d’un politicien et d’un homme mûr. (La Justice, 21 mars 1888)
1889 – « Mgr T. E. Hamel est descendu hier à Rimouski pour prêcher
une retraite de vocation aux élèves de philosophie et de Rhétorique
du petit Séminaire de cette institution. » (Courrier du Canada,
16 avril 1889)
1891 – Le Supérieur du Séminaire, le chanoine R.-Philippe Sylvain,
par l’entremise du Courrier du Canada, informe les parents
des enfants au séminaire de Rimouski qu'il n’y a pas de maladie
contagieuse dans cette maison. (24 décembre 1891)
1903 – « Le Messager de
Sainte-Anne nous apporte la nouvelle que le 13 juin dernier, c’était
jour de grande fête au Séminaire de Rimouski. Un Carillon-Sacré-Cœur
a été solennellement bénit. Et à cette occasion, M. le Supérieur du
Séminaire fit une allocution bien sentie par les élèves. » (La Croix, hebdomadaire de
Montréal, 5 juillet 1903)
1910 -
Un correspondant qui signe Samuel
Lepage écrit un très long article qui veut démontrer que M. Georges
Potvin est le véritable fondateur du collège de Rimouski. En
conclusion, il écrit : « Je n’ai pas personnellement plus
d’affection pour M. Potvin que pour M. Tanguay, et je ne suis pas
plus en dette de bons procédés de la part de l'un que de l'autre. Je
connais ce que M. Potvin a fait pour doter Rimouski d’un collège. Je
connais les services inappréciables qu’il a rendus à cette partie de
notre province, et je démériterais à mes propres yeux si je ne
faisais ce que je dois et puis faire pour qu’il soit proclamé le
fondateur du collège de Rimouski, persuadé comme je le suis que ce
titre lui appartient. » (Progrès du Golfe, 1er avril
1910)
1912 – « Si les partisans de l’abbé Potvin comme fondateur du
Séminaire voyaient leur opinion triompher, il y aurait 50 ans
aujourd’hui que le Séminaire de Rimouski fut fondé. L’abbé Potvin
écrivait lui-même au grand-vicaire Mailloux que le 2 février 1862,
il avait promulgué le premier règlement provisoire mis en vigueur
parmi les élèves dans le nouveau local où le rendez-vous leur avait
été donné, après les vacances et l’examen d’hiver qui s'était fait
dans une maison du village où se tenaient alors les classes. « Et
c'est moi. ajoute l’abbé Potvin, qui avais réglé cela. » « Mais il
est impossible encore de savoir d'une manière absolue quel est le
véritable fondateur du Petit Séminaire de Rimouski : Mgr Tanguay ou
M. Potvin ! La question n'est pas réglée. Le sera-t-elle jamais ? »
(Progrès du Golfe, 2 février 1912)
1912 – « Nous venons de recevoir la première livraison de février de
notre jeune confrère La Vie Écolière. Ce numéro, le septième depuis
la fondation du journal, contient une foule d’articles intéressants
et bien rédigés. (…) La Vie Écolière est l’organe des élèves de
Petit Séminaire de Rimouski qui, sous la direction d’un des prêtres
de la maison, collaborent à sa rédaction. On s’y abonne au prix de
50 cents par année. Ce journal, fondé depuis quelques mois, paraît
toutes les deux semaines et est publié au Séminaire de Rimouski. » (Progrès
du Golfe, 2 février 1912)
1913 - Les directeurs du Séminaire renouent avec une tradition
depuis longtemps abandonnée, soit celle de célébrer la fête du
Supérieur,
le chanoine
R.-Philippe Sylvain. On en profite pour souligner le
38e anniversaire sacerdotal de ce dernier. Près de 75
prêtres du diocèse ou d’ailleurs, sans compter ceux du Séminaire,
sont présents, de même que de nombreux laïcs, particulièrement des
anciens élèves. (Progrès du Golfe, 20 décembre 1913)
1917 – Le Progrès du Golfe
nous apprend que l’Académie St-Jean du Séminaire de Rimouski a été
fondée en 1875. (13 juillet 1917)
1918 – Le Progrès du Golfe nous apprend qu’en raison de la guerre il n’y a pas eu de distribution de prix celle année, les élèves en ayant fait d’avance la remise gracieusement aux autorités du Séminaire. (14 juin 1918) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6605
12 novembre 2022
Nouvelles brèves (1878–1883)
En faisant des recherches dans les journaux québécois, j’ai trouvé
des éléments d’information sur le Séminaire de Rimouski qui ont un
certain intérêt. Voici quelques-uns de ces éléments pour la période
donnée :
1878 - On nous apprend que le chanoine Winter, curé de l’Isle-Verte,
est allé dernièrement aux États-Unis pour quêter en faveur du
Séminaire de Rimouski auprès de la population de langue anglaise. Le
révérend Charles Guay l’avait précédé en sollicitant les Canadiens
français. Il est actuellement dans sa paroisse pour le temps pascal,
mais il compte continuer sa collecte en mai. (Journal de Québec,
9 avril 1878)
1880 - Le lendemain de sa nomination sur invitation spéciale, M.
Chapleau (premier ministre du Québec) se rendit au Séminaire de
Rimouski où il fut reçu par M. le Vicaire Général Langevin et les
professeurs de la maison. Une adresse de bienvenue fut présentée par
les élèves au chef du gouvernement et à ceux qui l’accompagnaient.
(La Minerve, 1er mars 1880)
1880 - On annonce que le tirage pour la loterie pour le Séminaire de
Rimouski se fera le 10 août prochain et les jours suivants. Il en
coûte une piastre le billet. Il y a 250 lots à gagner : terre,
cheval, voiture, bannière, chemin de croix, vases en argent plaqué,
bouquets, albums, volumes illustrés, montre d'argent, calumet,
modèle de goélette, paires de roues, chromos encadrés, etc. en plus,
600 messes pour les vivants et les défunts à l'intention des
porteurs de billets. (Le Quotidien, 15 juin 1880)
1881 – « La médaille présentée au Séminaire de Rimouski au premier
bachelier ès arts de cette maison, en l'année 1880, par Son
Excellence le Gouverneur Général le Marquis de Lorne, vient d'être
décernée par Sa Grandeur Mgr de Rimouski, à M. R .A. Drapeau, ancien
élève de ce Séminaire, et maintenant étudiant en droit à
l'Université Laval. » (Gazette des Campagnes, 20 janvier
1881)
1881 - Le collège de Rimouski a été entièrement détruit par un
incendie hier matin de bonne heure. Il n’y a pas eu perte de vie.
L'édifice était assuré pour 35 000 $ ; il valait 60 000 $. Les
pertes sont évaluées à 125 000 $. (La Minerve, 6 avril 1881)
1881 – « Les citoyens de Rimouski, immédiatement après l’incendie du
Séminaire se sont réunis et ont souscrit la jolie somme de 661 $
pour subvenir aux dépenses les plus pressantes occasionnées par cet
incendie. Nous les félicitons de cette générosité. Les citoyens de
Rimouski ont été cruellement éprouvés par cet incendie, car leur
Séminaire était l'une des premières maisons d'éducation classique de
la Puissance. C'était l'œuvre de Mgr Langevin qui avait consacré une
partie de sa vie à cette grande œuvre. » (Le
Quotidien, 12 avril 1881)
1881 – M. le chanoine F. E. Couture, préfet des études du petit
Séminaire de Rimouski, est actuellement à Québec. Le zélé prêtre
s’occupe activement de réparer les pertes causées par l’incendie à
la bibliothèque du Séminaire. M. l ’abbé L. Langis qui avait pu se
créer une collection assez considérable et bien choisie de livres de
théologie, a vu détruire en quelques minutes le fruit de tant de
sacrifices. M. l’abbé Bernard, ancien curé, a également perdu toute
sa bibliothèque dans ce désastre. (Courrier du Canada, 16 avril
1881)
1881 – Le Conseil de l’Instruction publique a adopté, dans une de
ses dernières séances, une résolution à l’effet d’octroyer une somme
de 1000 $ au Séminaire de Rimouski, suite à l’incendie du 5 avril.
(Courrier du Canada, 27 octobre 1881)
1882 – Pour faire suite à l’incendie du Séminaire de Rimouski, des
souscriptions au montant total de 14 851,48 $ ont été octroyées à
cette institution. La majorité proviennent des diocèses du Québec.
(Le Constitutionnel, 1er mai 1882)
1882 – À la suite de l’incendie du Séminaire de Rimouski, le
Grand-Vicaire C.-E. Légaré a pu obtenir 983 volumes pour la
bibliothèque ; les prêtres du Séminaire ont reçu 849 volumes et 23
cartes, formant en tout 1832 volumes et 23 cartes. (Gazette des
Campagnes, 4 mai 1882)
1883 – « Samedi le 10 courant, dans la chapelle du Séminaire, Mgr J. Langevin, évêque de Rimouski, conférait l’ordre sacré du sous-diaconat à M. A. Bérubé, professeur de rhétorique, et le diaconat à M. Aug. Gagnon, professeur de philosophie intellectuelle. M. A. Bérubé est le frère de M. Thomas Bérubé, curé de St-Simon, et de feu M. J. B. Bérubé, vicaire à Carleton, décédé il y a quelques années à l’Hospice des Sœurs de la Charité de Rimouski. » (Gazette des campagnes, 23 mars 1883) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6575
24 octobre 2022
Nouvelles brèves (1862-1876)
En faisant des recherches dans les journaux québécois, j’ai trouvé
des éléments d’information sur le Séminaire de Rimouski qui ont un
certain intérêt. Voici quelques-uns de ces éléments pour la période
de 1862 à 1876 :
1862 – « Le collège industriel et agricole de
Rimouski, qui a dû lutter pendant plusieurs années contre les plus
graves difficultés, semble prendre un nouvel essor, grâce au zèle
persévérant de M. Potvin qui s’en est fait lui-même le Principal.
Les examens ont été honorés de la présence d’un grand nombre de
personnes distinguées. Un cours d’agriculture a été fait dans cette
institution par M. Smith, auteur de plusieurs écrits sur cette
matière et l’on se propose prochainement d’annexer au collège une
ferme-modèle. » (Journal de l’instruction publique,
juillet-août 1862)
1870 – « Le collège de St-Germain de Rimouski fondé en 1862 prend
chaque année de nouveaux développements. Il compte de 120 à 130
élèves, et de grands efforts sont faits par l’évêque pour le rendre
digne de l’avenir qui attend son nouveau diocèse. » (Journal
de l’instruction publique, juillet 1870)
1870 – « Mgr Langevin à peine arrivé de Rome présidait aux examens
et à la distribution des prix (de juin 1870). Un discours de
circonstance fut prononcé par M. Napoléon Lapierre. Les élèves
furent interrogés publiquement sur la plupart des matières d’études
de l’année et répondirent avec assurance et exactitude. Après la
distribution des prix, Monseigneur Langevin et le sénateur Tessier
prirent la parole et dans de chaleureux discours engagèrent la
population du diocèse à donner à son Séminaire tout l’appui qu’une
telle institution mérite. » (Journal de l’instruction publique,
juillet 1870)
1871 – « La fièvre typhoïde fait des ravages depuis le commencement
de la semaine dernière à Rimouski ; trois personnes ont déjà
succombé à la maladie au palais de l’évêque et un grand nombre
d’autres sont dans un état dangereux. La maladie se propage
rapidement et, paraît-il, a originé dans le Séminaire. » (L’Ordre,
12 mars 1871)
1871 - On apprend le décès de Louis-Philippe-Alexis Lévêque, fils de
Célestin Lévêque, cultivateur de Rimouski, survenu le 25 mai à l’âge
de 21 ans. Cet élève du Séminaire de Rimouski « doué de talents
solides et brillants, rehaussés par l’éclat de sa piété, allait
terminer cette année avec de grands succès son cours commercial et
se disposait à entrer au cours classique latin ». Le jeune homme est
mort de fièvres qu’il avait contractées « environ 15 jours après la
sortie des élèves le 6 avril. » (Le Courrier du Canada, 5
juin 1871)
1872 – « Au Séminaire de Rimouski, la distribution des prix a eu
lieu mardi, le 2 juillet. Sa Grandeur présidait, accompagné de M.
le Vicaire Général, des Révérends Louis Desjardins, curé de
Ste-Cécile du Bic, Lessard et Sansfaçon du diocèse de Québec, et des
prêtres du Séminaire. La salle était remplie des parents des élèves
et d’un grand nombre d’amis de l’éducation qui ont emporté de là une
impression bien flatteuse pour les directeurs de cette jeune mais
florissante institution. » (Journal de l’Instruction publique,
Juillet 1872)
1872 – « M. Ulfranc St-Laurent est
le premier élève sorti du Séminaire de Rimouski qui ait encore été
promu au sacerdoce. Pour perpétuer le souvenir d’un événement qui
intéresse à un si haut point le jeune Séminaire de Rimouski, Sa
Grandeur Monseigneur Langevin, supérieur du Séminaire a accordé aux
élèves un grand congé le jour de la première messe de M. l’abbé
St-Laurent. » (Courrier du Canada, 14 octobre 1872)
1873 - Le Grand Séminaire de
Rimouski compte 24 ecclésiastiques dont 10 ont fait leurs études au
Petit Séminaire. (Le Canadien, 1er octobre 1873)
1873 - L’évêque de Rimouski cède en
pur don à la Corporation du Séminaire le terrain sur lequel se
construit le Séminaire. (Le Canadien, 1er octobre
1873)
1873 - Le Séminaire de Québec donne
200 $ au Petit Séminaire de Rimouski en vue d’acheter des volumes
pour la bibliothèque des élèves. (Le Canadien, 1er
octobre 1873)
1876 - « Dans toute la maison offrant un développement de 425 pieds de longueur sur 50 pieds de largeur règne un excellent système de ventilation, et avant peu sera partout établi un appareil de chauffage à l’eau chaude, et l’éclairage au gaz. » (Courrier du Canada, 30 août 1876) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6540
3 octobre 2022
Souvenirs de Samuel Lepage
Samuel Lepage, un arpenteur-géomètre qui a fréquenté le collège
industriel de Rimouski et qui a fait son cours classique alors que
le Séminaire succédait au collège, a écrit un précieux texte où il
montre l’évolution des deux institutions. Ce texte a été publié dans
le Progrès du Golfe du 4 mars 1910. Vu sa longueur
exceptionnelle, je l’ai résumé en parlant toujours à la première
personne.
1. Dans mon enfance, j’ai fréquenté à Rimouski, en 1855 et 1856,
l’école élémentaire de M. Hubert Catellier qui enseignait dans le
bas d’une maison située au nord du chemin public près de l’église
paroissiale. M. Cyrille Tanguay enseignait dans le haut de la même
maison qui appartenait alors, pour une moitié, à mon père, et pour
l’autre moitié à M. Pierre Ringuet. (…) M. Catellier enseignait aux
petits écoliers et M. Tanguay aux grands. Nous disions que nous
allions à l’école.
2. En 1856-1857, j’ai fréquenté la classe dite du collège industriel
de M. Cyprien Tanguay, curé de Rimouski. Cette classe était donnée
dans la maison de Mme Hector Crawley, au sud du chemin public. (…)
M. Lamoureux enseignait le français aux grands et M. Octave Ouellet
enseignait aux petits. M. James Smith enseignait l’anglais. Je
suivais la classe de M. Ouellet.
M. Jacob Côté, prêtre et vicaire de la paroisse, était directeur. Il
couchait généralement au collège. J’y couchais ainsi que trois de
mes frères plus âgés que moi. Je ne me rappelle pas avoir vu le curé
Tanguay faire la classe. D’ailleurs, M. Tanguay nous visitait
rarement et quand il le faisait, ça faisait époque, car il
était d’une dignité et d’une amabilité qui nous engageaient à
désirer que ses visites fussent plus fréquentes.
3. En 1857-1858, M. Lamoureux et M. Smith ont quitté. M. Jacob n’est
plus directeur et il ne couche plus au collège. Il n’y a plus de
dortoir pour les écoliers. Deux appartements seulement sont occupés
par les classes. M. Désiré Bégin enseigne l’anglais et le français
aux grands et M. Octave Ouellet enseigne aux petits. M. Tanguay ne
nous fit que deux ou trois courtes visites. Nous, les écoliers, nous
ne disions plus que nous allons au collège, nous disons que nous
allons à l’école et que le collège n’existe plus.
4. En 1858-1859, M. Désiré Bégin enseigne seul aux petits et aux
grands écoliers, toujours dans la maison de Mme Hector Crawley et
l’école n’occupe plus qu’un appartement. M. Tanguay ne nous fit que
deux ou trois courtes visites.
5. En 1859-1860, l’école est transportée dans une petite maison
d’environ 24 × 28 pieds à un seul étage. M. Bégin y enseignait aux
grands et se faisait aider par un de ses écoliers, un nommé Elzéar
Guay, qui enseignait aux petits dans le grenier mal éclairé de cette
maison. Au début de l’année scolaire, M. Cyprien Tanguay est nommé
curé de St-Michel-de-Bellechasse.
6. En 1860-1861, M. Bégin a aussi enseigné seul dans une maison
beaucoup plus grande, au sud du chemin. Il se faisait encore aider
par un de ses écoliers.
7. En 1861, dans le cours de l’été, les commissaires d’écoles,
prenant en considération le nombre toujours augmentant des garçons
qui fréquentaient l’école du village de Rimouski, engagent deux
maîtres auxiliaires à M. Bégin : MM. Michel Coulombe et Gaspard
Dumas, deux maîtres diplômés et compétents, encore dans la même
maison. Vers le mois d’octobre ou de novembre, le vicaire de la
paroisse, M. Georges Potvin, visite l’école. Il interroge les
enfants sur leurs progrès, en réprimande et en punit même. À la fin
de décembre, il nous fait subir un examen très sérieux et détaillé
sur les matières étudiées. Nous comprenons que M. Potvin a pris la
haute direction de l’école.
8. Le 2 février 1862, après une vacance de plusieurs semaines, M.
Potvin qui est président de la commission scolaire a fait
transporter l’école dans la sacristie de l’ancienne église. Il y
réunit tous les écoliers dont je suis et nous donne lecture d’un
règlement qu’il a préparé pour notre gouverne. Il assigne à chaque
élève la classe qu’il doit suivre, lui fournit les livres dont il a
besoin.
Les professeurs sont MM. Bégin, Coulombe, Dumas et Smith. M. Potvin,
toujours vicaire, agit en qualité de directeur, préfet des études,
procureur, maître de salle et de discipline et aussi professeur. M.
le curé Épiphane Lapointe est reconnu comme le Supérieur du nouveau
collège. L’école du village a disparu. Tout le monde, même à
l’extérieur, appelle cette nouvelle école le collège de M. Potvin.
Le programme d’études est à peu près celui du collège de
Ste-Anne-de-la-Pocatière et les livres distribués par M. Potvin
proviennent en grande partie de ce collège.
9. Depuis cette date du 2 février 1862, le collège de Rimouski a
toujours prospéré. J’y ai fait mon cours classique ainsi qu’un grand
nombre de mes confrères et compagnons dont plusieurs sont devenus
prêtres et d’autres ont embrassé des professions libérales.
10. J’affirme que jusqu’en 1866-1867 M. Potvin a été reconnu par
tous comme le fondateur du collège de Rimouski.
En conclusion, je soutiens que M. Potvin est le fondateur du collège
de Rimouski.
|
|
| Retour | Accueil |
|
# 6505
12 septembre 2022
James Smith et le collège
Dans le Progrès du Golfe du 19 juin 1936, Mgr R. Philippe
Sylvain, écrit un long article dans lequel il souligne l’implication
de James Smith dans les débuts du collège rimouskois. Voici un
extrait de ce texte :
« Américain d’origine, M. Joseph Smith, ministre presbytérien, de
White Mountains, N. H. vint résider à Caraquet, N.-B., vers 1800.
Cet homme droit qui cherchait la vérité la trouva dans la religion
catholique. Après une préparation sérieuse, il se convertit en 1812.
Le
plus jeune de ses enfants, James, alors âgé de neuf ans, fut envoyé
au collège de Ste-Anne de la Pocatière pour y commencer ses études.
Il les termina au Séminaire de Québec où il eut pour professeur M.
l’abbé Jean Langevin, et pour condisciple, Edmond Langevin. Après
avoir passé trois ans au Grand Séminaire, il rentra dans la vie du
siècle au moment d’être reçu sous-diacre.
Engagé comme instituteur, il passa six ans à St-Thomas de Montmagny.
De là, James Smith retourna à Québec où il fit du journalisme
pendant quelques années, puis il vint s’établir à Rimouski avec sa
famille en 1856. On le sait par la Chronique de Rimouski qui
nous dit que cette année-là James Smith s’offrit à enseigner
gratuitement l’anglais aux élèves du collège industriel.
En
1862, il est engagé par M. Georges Potvin pour enseigner
l’agriculture et l’anglais jusqu’à janvier 1863. Son fils ainé M.
Théodule Smith a été élève du Collège de Rimouski, y a fait tout son
cours classique et a été le premier finissant qui a pris la soutane
à l’arrivée de Mgr Langevin au mois de juin 1867. (…)
James Smith est une des figures les plus originales qui soient
passées par Rimouski, il y a soixante ans. Il est rare, en effet, de
rencontrer un homme doué de talents si variés, et surtout de voir
cet homme en faire un si bon usage. Son désintéressement a été
vraiment admirable, son abandon à la divine Providence, édifiant.
Instituteur, commerçant, journaliste, écrivain fécond, navigateur,
cultivateur, semeur d'idées qu’il jette le long du chemin sans autre
récompense que celle promise aux hommes de bonne volonté, il a passé
à travers toutes ces vicissitudes avec une égale résignation dans
l’épreuve comme dans le succès. Je ne saurais faire le portrait de
ce digne homme mais je puis dire que sa rencontre est un des
meilleurs souvenirs de ma jeunesse.
Il
est mort à Matapédia, en 1889. Quelques-uns de ses descendants y
vivent encore. » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6465
12 juin 2022
Soixante-dix ans plus tard
Quand le Séminaire de Rimouski souligne un anniversaire de
fondation, les journaux ne manquent pas de participer aux fêtes en
proposant un historique rafraichi. C’est ainsi que le Soleil
du 17 juin 1940, dans le cadre du 70e anniversaire,
propose un court texte qui traite principalement des premiers pas du
Collège.
« Le Séminaire est sorti du Collège industriel fondé en 1855 par
Monseigneur Cyprien Tanguay, alors curé de Rimouski. Le latin y fut
introduit en septembre 1863 ; à partir de cette date, il est donc
devenu collège classique. Le premier évêque de Rimouski, Mgr Jean
Langevin l'a élevé, en novembre 1870 au rang de séminaire diocésain.
Le cinquantenaire de cet acte a été célébré en 1920 par un grand
conventum. Voici ce que dit l’Album-souvenir de Rimouski publié en
1929 au sujet du Séminaire de Rimouski. ! « En 1853. M. le curé
Tanguay projeta la fondation d'un collège industriel. Lorsque fut
décidée la construction d'une nouvelle église en 1854, il fut
entendu que la vieille église serait transformée en collège. Mais on
n'attendit pas si longtemps pour fonder l'institution rêvée. Dès
1855, le collège industriel occupait une maison louée, dont le site
est occupé maintenant par le hangar du magasin H.-G. Lepage Ltée.
Après bien des vicissitudes, une ère nouvelle s'ouvrit en 1862 alors
que M. Georges Potvin vicaire à Rimouski, réussit à faire donner
l'église désaffectée à la Commission scolaire qui y fit aménager des
salles et des classes. Les élèves se transportèrent en 1862 dans
leur nouveau local, et l'année suivante on commença l'enseignement
des langues
classiques.
En 1866, un
élève
va subir
à
Québec
l'examen du baccalauréat.
En 1868, mandement de Mgr Langevin annonçant
la construction prochaine d'un séminaire
et d'un
évêché,
et demandant quinze sous par communiant pendant dix ans.
Le 4 novembre 1870, a lieu l’érection canonique du Séminaire, sous
le patronage de Saint-Antoine de Padoue. Le 12 septembre 1871, on
bénit la pierre angulaire de la nouvelle construction qui fut
terminée en 1876 et bénite solennellement par Mgr Taschereau,
archevêque de Québec, le 31 mai de la même année. Cet édifice, qui
avait 250 pieds de façade, et deux ailes de 100 pieds, était bâti à
quelques dizaines de pieds au sud de la façade du Séminaire actuel.
Les élèves quittèrent cette année-là l’église qu’ils occupaient
depuis 14 ans.
Ce troisième séminaire a duré, mais on lui a adjoint une aile de 101
pieds, en 1905. Et en 1922, commencèrent les nouvelles constructions
qui contiennent les salles et les classes du Petit Séminaire. La
façade nouvelle a 350 pieds ; l'aile de la chapelle qui rejoint les
anciennes bâtisses a 160 pieds. La bénédiction du nouveau Séminaire
eut lieu le 5 novembre 1925. (photo ci-contre)
Les 19 et 20 juin 1940, de grandes fêtes marqueront le 70e anniversaire de fondation de cette institution. » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6440
27 mai 2022
Le conventum de 1920
Le Progrès du Golfe du 25 juin 1920 fait état d’un conventum
d’anciens au Séminaire de Rimouski dans le cadre du cinquantième
anniversaire de l'érection canonique du Séminaire en institution
diocésaine.
« À l’occasion du cinquantenaire de leur Alma Mater, près de 700
anciens venus de toutes les parties du continent se sont réunis en
conventum général au cours de cette semaine. Ce conventum a eu un
immense succès d’assistance et d’enthousiasme.
Le programme habilement préparé a été,
dans tous les détails,
accompli à la perfection avec un joyeux entrain et un enthousiasme
qui s’est
accru d’heure
en heure jusqu’à
la fin.
Sa Grandeur Mgr Léonard,
en sa qualité
d’ancien
élève, fut l’un des plus assidus, du premier au troisième jour. Dans
l’après-midi de mardi, après l'arrivée des convois, il y eut réunion
plénière des anciens qui furent heureux de se retrouver si bien
ensemble, se faisant reconnaître, causant avec abondance, faisant
les présentations des amis et confrères
à
d’autres
amis et confrères
qui ne les connaissaient pas avant, se disant des
« noms »
comme autrefois, badinant, riant et s’amusant
à
qui mieux mieux, et bien mieux qu’autrefois.
Sous une vaste tente, qui servait de réfectoire, les repas se
prirent en commun, servis par les élèves actuels admirablement
dressés et remarquablement empressés au service de leurs aînés.
Mardi soir, tous se rassemblèrent dans la salle des promotions où
eut lieu un magnifique concert donné par les membres de l’orchestre
et de la chorale du Séminaire sous la direction de l’abbé Alphonse
Fortin.
M. le Supérieur, le chanoine Fortunat Charron, fit l’allocution de
bienvenue officielle, à laquelle répondirent S. E. Mgr Léonard,
évêque de Rimouski, et M. A.- Pierre Garon, C. R., ancien magistrat
du district.
L’abbé Antoine Poirier, curé de Cap d’Espoir, ancien élève, ancien
procureur et ancien directeur du Petit Séminaire, fit une causerie
sur le “bon pieux temps”, suivi en cela par M. l’avocat Flynn, de
Percé. (…)
Après la séance, on se dispersa, les uns allant aux dortoirs dans
l’espoir de se reposer, les autres partant en groupe, avec grosse
cloche, tambour, cymbales, trompettes, clochettes, grelots, klaxons,
et autres instruments harmonieux, pour aller sérénader les
« anciens » de la ville qu’ils supposaient retirés dans leur demeure
pour la nuit. La population fut tenue éveillée toute la nuit par les
chants et les sérénades de la bande qui allait d’une maison à
l’autre, réclamant un discours à chacun de ceux qu’elle allait si
libéralement saluer. Après un bon chahut … de plusieurs heures, et
de nombreux discours (du haut des fenêtres, des galeries et des
vérandas) arrachés à ceux que les joyeux gaillards allaient en
cortège, imposant par le nombre et le bruit, réclamer de leurs vieux
et jeunes confrères dont plusieurs étaient dans le plus profond
sommeil, les manifestants radieux se rendirent derechef au Séminaire
où ils accomplirent la même délicate tâche auprès de ceux qui s’y
reposaient (…).
La nuit si bien commencée s’acheva dans la grande salle du
Séminaire, au milieu d’une nombreuse et vivante assemblée, par des
discours qui, pour n’être pas officiels, n’en furent pas moins
vibrants, enthousiastes et vigoureusement applaudis. Cette assemblée
nocturne et en marge du programme, qui commença et s’acheva par des
chants d’allégresse, se tint sous la présidence d’un maître de salle
qui (…) n’était autre que le « vieux chef » Charles Gauvreau,
spontanément élu président et premier maître de salle de cette
troupe de turbulents écoliers de 25 à 75 ans. (…)
Mercredi avant-midi, une messe pontificale réunissait les
« conventionnels » à la cathédrale. Le Rév. Père Rouleau, provincial
des Dominicains, prononça le sermon de circonstance. La messe fut
suivie d’un somptueux banquet au Séminaire dans la vaste
tente-réfectoire, sous la présidence de M. le Supérieur Charron. (…)
Mercredi soir,
eut lieu, sous la présidence de Mgr l’Évêque, la distribution
solennelle des prix aux élèves actuels (…).
Le lendemain, à la cathédrale, un service funèbre fut chanté pour le repos éternel des anciens que la mort a fauchés depuis la fondation du Séminaire. Puis, ce fut les adieux, la dispersion et le départ, le retour de chacun vers son foyer. (…) » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6410
9 mai 2022
Débuts héroïques
du Collège
La Gazette des campagnes du 4 mars 1886 insiste sur l’apport
considérable du révérend Georges Potvin dans la fondation du Collège
de Rimouski. Voici ce texte :
« M. George Potvin est né à Ste-Anne-de-la-Pocatière le 11 juillet
1834. Il entrait au Collège de Ste-Anne en septembre 1844 où il y
fit son cours classique. Ordonné prêtre à Québec le 25 septembre
1859, M. Potvin fut dans le même temps nommé vicaire à St-Germain de
Rimouski, où la Divine Providence l'appelait à préparer et à
réaliser de grandes choses pour la plus grande gloire de la religion
et le bien de son pays.
Le Rév. M. Épiphane Lapointe, alors curé de Rimouski, reconnaissant
dans son jeune vicaire, un travailleur plus qu’ordinaire, lui confia
la charge de surveiller l’enseignement de la jeunesse, et il en
profita pour donner cours à un projet qu'il mit à exécution à la
lettre avec la plus grande persévérance et le plus grand dévouement,
comme l’histoire saura le lui témoigner. Après trois années d’un
travail opiniâtre et une persévérance à l'égal de son zèle, il
établissait un collège dont il a été le premier directeur, ayant
pour premier supérieur le Rév. M. Épiphane Lapointe.
L’année suivante, par la mort du révérend M. Lapointe, le Rév. M. L.
Lahaie devenait curé de Rimouski, et en cette qualité deuxième
supérieur du Collège, M. Potvin remplissant à la fois les charges de
directeur, procureur et professeur de cette nouvelle institution. M.
Potvin occupa ces trois charges jusqu'à 1866-1867 ; il fut alors
remplacé par le Rév. M. Ferdinand Laliberté comme directeur, M.
Potvin n'étant alors que procureur, l'état de sa santé le forçant à
prendre un peu de repos.
Nous voyons par ce qui précède que le fondateur du Collège de
Rimouski ne se ménageait pas pour établir, sur des bases solides,
son œuvre de prédilection. Dans l'été 1867, M. Potvin remettait
définitivement son collège entre les mains de Mgr Langevin qui lui
déclara, dans une lettre, que c'était lui qui l'avait commencé,
organisé et soutenu presque sans ressources et avec un dévouement
extraordinaire et presque surhumain. C'était bien dire qu'il en
était le fondateur.
À ce précieux témoignage du premier prélat du diocèse de Rimouski,
nous ajoutons le suivant du Rév. M Bérubé, extrait d'un discours
prononcé en présence des évêques, du clergé, des laïcs les plus
éminents au Canada, lors de la bénédiction de la bâtisse du
Séminaire de Rimouski, dont on ne voit aujourd’hui que les sombres
restes :
(…) « Dans un pauvre appartement, sans feu, malgré nos rigoureux
mois d'hiver, un homme se livrant à des veilles sans fin, à un
travail fébrile. Voyez-le tout à coup parcourir les différentes
parties de la maison, où partout sa présence est requise. Ici il
crée ; là il transforme : partout il fait des prodiges. Tout à la
fois directeur, procureur, professeur, préfet d’études, de
discipline, il est partout et à tout. Obstacles sans cesse
renaissants, maladie, froid, travail herculéen, sacrifices héroïques
et de tous les genres : rien ne l’arrête, il court, il bondit. (…) »
En septembre 1866, Mgr l’Archevêque Baillargeon, en envoyant au Collège de Rimouski un prêtre qui devait aider M. Potvin et le remplacer comme directeur, écrivait à celui-ci, dans une lettre à son adresse, que « le Collège le reconnaîtrait avec justice pour son véritable fondateur. » Le 27 août 1867, M. Potvin se retirait du Collège de Rimouski, épuisé de fatigues, pour prendre cette fois, bien qu'à regret, un repos qui lui était rigoureusement nécessaire. » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6385
24 avril 2022
Distribution des prix en 1936
Le Progrès du Golfe du
19 juin 1936 publie un compte-rendu de la distribution des prix et
de la prise de rubans au Séminaire de Rimouski en cette fin d’année
scolaire.
« La salle de réception du Séminaire fut envahie par une foule
considérable, mardi après-midi, le 16 juin, à l’occasion de la
distribution des prix. Sa Grandeur Mgr Georges Courchesne présida la
cérémonie ayant à ses côtés M. le Supérieur Lionel Roy, M. le
directeur Fortunat Gagnon, M. le curé Adolphe Tremblay, et plusieurs
dignitaires ecclésiastiques.
Une marche d’ouverture fut exécutée au piano par deux élèves. Tour à
tour, défilèrent sur la scène les élèves de chaque classe, appelés à
recevoir leurs prix, qui étaient remis à Sa Grandeur par M. l’abbé
Georges Dionne, préfet des études. De nombreux prix spéciaux furent
décernés. Suivit la collation des diplômes aux finissants du cours
commercial, M. Gérard Arsenault, Léopold Boucher, Laurent Côté,
Gérard Dubé, Aurèle Landry, Jacques Michaud, Fernand Otis, Antonio
Poirier et Roland Racine.
Selon la tradition, M. le Supérieur du Séminaire invita M. l'abbé
Philippe Morin, curé de Price, à parler au nom des anciens. Le
conférencier d'honneur fit une brillante allocution, pleine d’esprit
et d’humour, exquisement émaillée de ses souvenirs d’étudiant,
applaudissements chaleureux et répétés de l’assistance exprimèrent
hautement combien M. le curé Morin a su, par son étincelant et bref
discours, intéresser ses nombreux auditeurs.
La
prise des rubans révéla au public la carrière que chaque finissant
du cours classique se propose d’embrasser.
•
Se dirigeront au Grand Séminaire : Réal Bernier, Gérard Cayouette,
Paul-Émile Rioux, Lucien Roy et Philippe St-Laurent
•
Chez les Pères blancs : Léopold Belzile, Alphonse Bélanger, Lionel
Dion et Jean-Louis Péloquin
•
Missions Étrangères : M. Lucien Beaulieu
•
Le droit : Simon Langlais
•
La médecine : Delphis Lévesque
•
École Supérieure de chimie : Léo-Paul Garon et Laurent Riou
•
Le journalisme : Maurice Tremblay
•
Le génie minier : Paul-Émile Beauchemin et Rodrigue Brillant
•
Le génie civil : Paul-Henri Gaudreau
•
Ingénieur-chimiste : Aurèle St-Laurent
•
Hautes études commerciales : Aubin Morin
•
Agronomie : Paul-Émile Charron
•
École normale supérieure : Yvon Landry et Jean-Marie Pérusse
M. Maurice Tremblay se fit
l’interprète de ses confrères finissants dans une émouvante adresse
d’adieu. M. le Supérieur revint pour remercier Son Excellence Mgr
Courchesne d’avoir si gracieusement accepté de présider cette séance
et adressa paternellement des conseils aux nouveaux … anciens.
Dans son discours, il souligna l’existence de l’École des Arts et Métiers, due à la générosité de M. Jules A. Brillant, les bienfaits dont plusieurs ont déjà bénéficié depuis sa récente fondation. (…) » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6360
9 avril 2022
Cinquante ans plus
tard
Le journal Le Droit du 23 juin 1920 publie un court
historique du Séminaire de Rimouski dans le cadre du 50e
anniversaire de sa fondation.
« Toute la ville est en liesse. On
fête le cinquantième anniversaire de l’érection canonique du
Séminaire de Rimouski. Les anciens élèves invités par M. le
Supérieur, en novembre dernier, viennent en grand nombre saluer
l’Alma Mater grandie et toujours plus belle. Les cérémonies de cet
anniversaire sont marquées par un esprit de réjouissance et de
reconnaissance pour les dévoués fondateurs et zélés professeurs qui
ont participé à l’œuvre admirable du Séminaire de Rimouski.
Historique
L’origine (…) fait l'objet de nombreuses controverses. Plusieurs
historiens qui font remonter
la fondation du Séminaire à 1854 déclarent que Mgr Cyprien Tanguay,
le généalogiste, qui a été curé de Rimouski de 1850 à 1859 en est le
fondateur. D'autres font remonter la date de la fondation à 1861 et
prétendent que M. l'abbé Georges Potvin en est le fondateur
véritable.
Il existait quand Mgr Jean Langevin prit possession de son siège
épiscopal en 1867. Un an auparavant même, un élève, Théodule Smith,
aujourd’hui vénérable curé en retraite sur les rives de la
Baie-des-Chaleurs, subissait les examens du baccalauréat. Dès ce
moment donc, on est déjà fixé sur l’existence et le caractère de la
maison nouvelle d'enseignement, puisqu'on y enseigne grec et latin
et qu'on subit les examens de l'Université Laval.
Mais les débuts sont lents et difficiles. Le pays est pauvre. La
population n’y est pas dense. Les prêtres sont peu nombreux, Il faut
faire jaillir de terre, en quelque sorte, habitation, élèves et
professeurs. « Nos chers Frères, vous le comprenez facilement, ce ne
sont là que de faibles commencements, ce n’est qu'au moyen de
privations réelles, d'une gêne incroyable que le Procureur a pu
jusqu’à présent soutenir l’établissement : encore est-il endetté.
Les pensions sont extrêmement modiques, elles se paient en grande
partie en effets, et assez mal. »
À l’arrivée à Rimouski de Mgr Langevin en mai 1867, il trouvait 76
inscriptions. Tant d’externes que de pensionnaires sur les registres
des directeurs. L’année suivante, le nombre s’élève à 86. En
1868-69, il atteint mathématiquement le 100 puis successivement 112,
118 et 123 en 1872.
Entre temps, le 27 décembre 1868, Mgr Langevin avait ordonné dans
son diocèse la quête dite des quinze sous en faveur de son collège.
En rêvant de la bourse rondelette que ne manqueraient pas de faire
les quinze sous de ses diocésains, le vénérable évêque érigeait
canoniquement en petit et en grand Séminaire le collège de sa ville
épiscopale, le 4 novembre 1870.
Les quinze sous cependant s’amoncelaient lentement… « qui va
doucement va longtemps ». Tant et si bien qu’un magnifique édifice à
quatre étages, en pierre taillé s’éleva bientôt sur la colline qui
domine le fleuve.
Le rêve réalisé
Le rêve de Mgr Langevin était réalisé. Pour remercier Dieu avec lui
et leur faire partager son allégresse, il voulut inviter ses
collègues dans l’épiscopat à venir à Rimouski, le 31 mai 1876, faire
la dédicace solennelle de ce nouveau temple de la sagesse.
« Dieu ménageait une épreuve à celui qui l’avait fait construire au
prix de tant de sacrifices. Le 5 avril 1881, le feu la consuma de
fond en comble. » (Chronique collégiale).
Les jours sombres
« Les amis de l'éducation vinrent au secours d'une si grande
infortune, et avec les assurances, les souscriptions et l’aide du
gouvernement provincial, le conseil du Séminaire paya ses dettes. »
(Chronique collégiale).
En attendant des jours meilleurs, toute la communauté redescendit
la colline gravie avec tant de joie cinq ans auparavant et se
réinstalla dans cet asile du malheur qu'était maintenant l’ancienne
église. On y resta jusqu'à l'automne de 1882.
Le renouveau
« Vint pourtant le jour où les économies dévouées des Procureurs et
de celles de quelques bienfaiteurs furent assez rondes pour qu'on
entreprit un agrandissement devenu plus que nécessaire. Il eut lieu
en 1905. » (Le Progrès du Golfe, 24 décembre 1909)
Et nous pourrions ajouter que, dès l'année suivante, il était insuffisant. Destinée par les architectes à recevoir 200 pensionnaires au plus, la maison agrandie dut en recevoir 225 et bientôt 260. Les classes jaugées, si l'on peut dire pour 250 élèves externes y compris, en ont reçu ces dernières années plus de 300. (…) » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6330
21 mars 2022
Le collège de Rimouski
(1862-1867)
Le
Courrier du Canada du 10 décembre 1883 explicite le rôle de
différents intervenants dont le révérend Georges Potvin et Mgr
Langevin, premier évêque de Rimouski, dans les débuts du Séminaire
diocésain. Voici ce texte :
« En 1864, les commissaires d’écoles de Rimouski, ayant alors le
contrôle sur le collège de Rimouski, et figurant comme directeurs de
ce nouvel établissement, dans un appendice au rapport général fait
au Département de l'instruction publique, déclarèrent unanimement
que la fondation du collège de Rimouski était due au Rév. M. Georges
Polvin, alors directeur, et que cette fondation remontait au 2
février 1862. Ces commissaires étaient Joseph Magloire Hudon avocat,
André Elzéar Gauvreau, régistrateur, Édouard Martin, marchand et
Pierre Ringuet, cultivateur. Leur secrétaire était Jean-Théophile
Couillard, marchand et maire actuel de la ville de Rimouski.
- 2 Février 1862. Ouverture
des classes du Collège de Rimouski dans l'ancienne sacristie.
- 27 Juillet 1862. L'ancienne
église de Rimouski cédée par les marguilliers pour y tenir les
classes du Collège de Rimouski.
- 4 Septembre 1862. Rév. M.
Georges Potvin, maintenu directeur du Collège de Rimouski.
- 30 Août 1863. Mgr
Baillargeon permet de dire la Ste-Messe dans le Collège de Rimouski.
- 2 Septembre 1863. Ouverture
du cours classique à Rimouski, Humanités.
- 2 Septembre 1863. Ouverture
du pensionnat du Collège de Rimouski, 6 Professeurs et 23 élèves
pensionnaires.
- 25 Septembre 1863. Dédicace
de la chapelle du Collège de Rimouski.
- 31 Octobre 1863. La première
Messe dite au Collège de Rimouski pour les bienfaiteurs de ce
Collège.
- 31 Octobre, 1er,
2 Novembre 1863. La première retraite donnée aux élèves du Collège
de Rimouski.
- 6 Février 1864. Requête à
Mgr Baillargeon pour obtenir un prêtre et des ecclésiastiques.
- 27 Mai 1864. Mgr Baillargeon
promet un prêtre et demande lui-même R. M. Fortier, Supérieur actuel
à Lévis.
- 29 Juillet 1864. Mgr
Baillargeon permet deux classes de Latin, Humanités et Versification
et donne un ecclésiastique.
- 1er Septembre
1864. Mgr Ignace Langlais, aujourd’hui Père de Ste-Croix est le
premier ecclésiastique employé au Collège de Rimouski.
- 1er Septembre
1864. Rév. M. Luc Rouleau aujourd’hui curé de Matane, est le
deuxième prêtre employé au Collège de Rimouski.
- 29, 30 Septembre, 1er
Octobre 1864, deuxième retraite donnée aux élèves du Collège de
Rimouski .
- 17 Juillet 1865. Mgr
Baillargeon donne la tonsure à M. Ignace Langlais, ecclésiastique,
dans l’église paroissiale, l'ordination à Rimouski.
- 8 Août 1865. Mgr Baillargeon
permet d'enseigner les Belles-Lettres au Collège de Rimouski.
- 21 Août 1865. M. Maxime
Hudon, deuxième ecclésiastique donné pour deux ans au Collège de
Rimouski.
- 27 Mai 1866. Mgr Baillargeon
offre à M. Potvin le Rév. M. F. Laliberté aujourd'hui curé du
St-Henri, pour l’aider.
- 4 Juin 1866. M. Théodule
Smith, 1er élève de Rimouski. aujourd'hui curé de
St-Godefroy, subit à Québec les épreuves du baccalauréat.
- 11 Juin 1866. M. le Recteur
de l’Université aujourd'hui Mgr l'Archevêque Taschereau félicite à
cette occasion le Collège de Rimouski.
- 13 Juin 1866. Abjuration du
M. William McPherson, élève du Collège de Rimouski.
- 29 Août 1866. Rév. M. L.
Laliberté, 3e prêtre donné à Rimouski et le second
directeur de ce Collège, il enseigne la philosophie.
- 6 Septembre 1866. Rév. M.
John Golfer, 4e prêtre donné au Collège de Rimouski et
trois ecclésiastiques : M. Charles Rouleau, M. Ernest Hudon et M.
Placide Beaudet.
- 4, 5, 6 octobre 1866.
Retraite des élèves du Collège de Rimouski prêchée par Rév. M. J. B.
Blanchet, curé de St-Luce, qui donne la somme de St-Thomas.
- 18 Mai I867. Mgr Langevin
dit la Ste-Messe pour la 1ère fois dans la chapelle du
Collège de Rimouski.
- 16 juin 1867. Mgr Langevin
permet au 1er élève de Rimouski, M. R. Smith, de prendre
l’habit ecclésiastique.
- 21 août 1867. Première retraite des prêtres du diocèse de Rimouski au Collège de Rimouski. » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6290
24 février 2022
Un quêteux efficace
Le révérend Charles Guay (1845-1922) a eu une
carrière atypique. Il a reçu de nombreuses missions spéciales de la
part de l’évêque comme celle de confirmer sur la Côte-Nord et de
quêter pour l’œuvre du Séminaire de Rimouski à travers le Québec,
aux États-Unis et même en Europe. Il a écrit six livres
dont un de 507 pages :
Chronique de Rimouski en
1873. Ses relations avec l’évêque ont parfois été
conflictuelles.
En 1878, il sollicite les aumônes chez les
Canadiens-français des États-Unis. La même année, il est en France.
J’ai trouvé deux articles de journaux qui relatent ses interventions
dans ce dernier pays.
1.
Courrier du Canada, 19 novembre 1878
« Voici ce que nous lisons dans la Semaine
religieuse de Rouen : (…) Le diocèse de Rimouski, (Bas-Canada)
fait appel en ce moment à notre charité. Un de ses Grands Vicaires,
M. l’abbé Guay vient au nom de son évêque et avec l'autorisation de
son Éminence le Cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen,
solliciter les aumônes des fidèles pour les besoins pressants de
cette contrée.
Le
diocèse de St-Germain de Rimouski. érigé en 1867, par Pie IX occupe
une très vaste superficie de territoire, et compte environ 80 000
catholiques. Monseigneur Jean Langevin, le 1er évêque de
Rimouski avait tout à créer dans ce nouveau diocèse. Sa première
pensée a été d’attirer des prêtres et des missionnaires à son
diocèse, et dans ce but, il a commencé la construction d’un
Séminaire : toutes les ressources dont il pouvait disposer ont été
consacrées à cette œuvre de première nécessité, encore inachevée...
pour faire face aux autres besoins urgents.
Il
s’adresse à la France et particulièrement en ce moment, à la
Normandie ; il espère que la Normandie si généreuse et si
affectionnée au Canada, lui viendra en aide. M. le Vicaire Général
de Rimouski a été autorisé par Monseigneur le Cardinal à prêcher et
à quêter dans les paroisses du diocèse qu’il visitera durant son
séjour parmi nous. Une liste de souscriptions sera ouverte dans
notre feuille, en faveur du Séminaire de St-Germain de Rimouski.
M. l’abbé
Guay doit porter la parole le dimanche de la dédicace dans l’église
St-Romain aux messes de 8 h et de 10 h. Le dimanche qui a précédé la
fête de la Toussaint, M. l’abbé Guay a été invité à dîner chez Son
Éminence le Cardinal en compagnie de M. l'abbé Bouillard, premier
aumônier de l’Hôtel-Dieu, dont il est l’hôte. » (Fin du texte cité)
2. Gazette des Campagnes, 6 février
1879
« On sait
que M. l’abbé Charles Guay, chanoine de Rimouski, est allé en Europe
pour solliciter quelques aumônes en faveur du Séminaire de Rimouski.
Le dernier numéro du Nouvelliste de Rimouski nous disait que
la mission de M. l’abbé C. Guay avait été couronnée d’un plein
succès. Il a reçu partout l’accueil le plus empressé. Les principaux
journaux catholiques comme le Monde et l’Univers ont
ouvert des listes de souscription qui ont réalisé des sommes
considérables.
« À la
fin de décembre, M. l’abbé C. Guay était à Amiens où il visitait le
noviciat des Pères Dominicains. Depuis le 15 novembre, il avait déjà
récolté au-delà de 10 000 francs, auxquels il faut encore ajouter
5000 à 6000 francs en vases sacrés et autres présents.
La duchesse de Chartres lui a donné des cloches superbes qu’il devait faire bénir à Rouen. Son Altesse Royale avait bien voulu en être la marraine. Madame la Maréchale de St-Arnaud lui a donné aussi un superbe calice d’or. Évidemment la France est très sympathique à l’œuvre de l’apôtre canadien. » (Fin du texte cité) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6265
9 février 2022
Une fête imposante
Dans son édition du 8 mai 1874,
le Courrier du Canada, quotidien de Québec, décrit une
fête au Séminaire de Rimouski :
« Le 30 avril 1874, une fête en l’honneur du septième anniversaire
de la consécration de Mgr Jean Langevin, premier évêque de Rimouski,
fut organisée au Séminaire. L’auteur de l’article souligne :
« Jamais le public de cette localité n’avait été jusqu’ici le témoin
d’une aussi imposante solennité. Tout a concouru à rendre la fête
belle : musique instrumentale, vocale avec orchestre, discours de
circonstances, drames qui ont été hautement appréciés des auditeurs,
tant les jeunes élèves se sont bien acquittés de leurs rôles
respectifs. Au témoignage universel, ces jeunes messieurs ont joué
leur rôle avec un aplomb et une exactitude tels que nous ne saurions
voir mieux sur les grands théâtres de l’ancien monde. Aussi pendant
tous les différents actes, ils ont rencontré les applaudissements
frénétiques de l’auditoire. »
Sous le titre « Soirée musicale, dramatique et littéraire », voici
le programme ambitieux de la soirée :
1. Cantate pour fête de supérieur
par un chœur des élèves
2. Adresse à Monseigneur par Pierre
Gauvreau, élève de Philosophie
3. L’ange exilé, déclamation
par Alfred Drapeau, élève de quatrième
4. La mort d’Abel, solo par
Alphonse Martin, élève de Philosophie
5. La mort d’Abel,
déclamation par Pierre Gauvreau
6. Le p’tit Polyte, chanson
comique par Horace Pelletier, élève de seconde
• Drame en trois actes :
L’Explication
Personnages :
Robert de Lusigny – A. Drapeau,
élève de quatrième
Flavy – Percy Philips, Philosophie
Loredan – A. Martin, Philosophie
Rinaldi – S. Grenier, Philosophie
Beppo – P. Fournier, Versification
Cabaretier – A. Chamberland,
Belles-Lettres
Assassins – Pierre Brillant et
Alphonse Fournier, Versification
Un garde – J. Grenier, Humanités
Un fantôme – J. Lavoie,
Belles-Lettres
7. Premier acte du drame
8. Le désert de Félicien David,
4e partie, la nuit – Solo par Charles Gauvreau, troisième
9. Deuxième acte du drame
10. Les deux aveugles –
Chanson comique par … Chamberland
11. Troisième acte du drame
12. Les guides des Bagnères
– Chœur des élèves, solo par Élie D’Anjou, Versification
13. God save the Queen (en
très petits caractères dans le texte)
Le
représentant des élèves, Pierre Gauvreau, a souligné à grands traits
« la joie universelle qui débordait de tous les cœurs et qui
paraissait sur toutes les figures » lorsque les élèves ont appris
que Mgr Langevin venait d’être nommé évêque de Rimouski. Il
mentionna que, dans leur allégresse, un cri s’échappa spontanément
de leurs cœurs. « Vive le père bien-aimé que le Seigneur nous envoie
dans sa miséricorde et sa bonté pour répandre ses bénédictions sur
nous et sur la maison où nous devons recevoir le bienfait de
l’éducation. » Il souligna le travail immense fait par Mgr Langevin
pour faire grandir le nouveau Séminaire diocésain et pour permettre
à plusieurs jeunes d’avoir une éducation de qualité.
Dans le mot de la fin, Mgr Langevin a félicité les élèves pour leurs magnifiques prestations et a souligné le dévouement des prêtres du Séminaire. À cette fête assistaient plusieurs membres du clergé tant du diocèse de Rimouski que de celui de Québec. |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6240
24 janvier 2022
Une distribution de prix
Dans son édition du 13 juillet 1870,
Le Courrier du Canada, qui
se présente comme le journal des intérêts canadiens, fait un
compte-rendu d’un examen public oral et de la distribution des prix
de fin d’année de juin 1870 au Séminaire de Rimouski.
« Les distributions de prix aux élèves de cette institution sont
toujours pour le public l’objet d’un vif intérêt et pour l’élève un
jour de bonheur et d’ivresse qui fait palpiter son cœur, car il lui
amène l’arrivée des vacances. Disons de suite que ce n’est pas sans
raison. Il y a donc généralement pour le public l’occasion de juger
de l'excellence du système classique des professeurs et des progrès
des élèves, et pour ceux-ci, celle de montrer qu'ils ont su profiter
de la direction supérieure imprimée à leurs études et ensuite le
bonheur de revoir le toit paternel qu’une année d’absence a rendu
plus cher.
Aussi, il n’est pas étonnant que les moindres occasions où il est
donné au public d’assister, soit à des distributions de prix ou à
d’autres démonstrations du même genre, soient saisies avec tant
d’empressement, et nous pouvons, en toute sincérité assurer les
messieurs de ce Séminaire, que si les invitations à cette solennité
n’étaient pas comparativement aussi restreintes, leurs salles
pourtant assez vastes, ne suffiraient pas pour contenir la foule des
amis de l’éducation qui désireraient partager la bonne fortune des
élèves.
Nous ne surprendrons personne en disant qu’il y avait salle comble,
jeudi dernier, au Séminaire de Rimouski à l’occasion de l’examen et
de la distribution solennelle des prix aux élèves de cette
institution. Il y eut deux séances : la première commença à huit
heures a. m. et se termina à midi et la seconde commença à 1½ h de
l’après-midi pour ne se terminer qu'à six heures. Mgr Langevin
présidait, donnant en cette circonstance une nouvelle preuve de sa
sollicitude et du haut intérêt qu'il porte à la cause de l’éducation
de la jeunesse.
À ses côtés, on remarquait M. le Grand Vicaire Langevin, l'Hon. U.
J. Tessier, un nombre très considérable de membres du clergé,
plusieurs laïcs distingués et la plus grande partie de nos dames
d’élite. Le discours d’ouverture fut prononcé par M. Napoléon
Gagnier. Ce discours renfermait de nobles pensées et fut débité avec
grâce.
Après quelques morceaux de déclamation, entremêlés de musique et de
chant, on commença l’examen. Nous devons cette justice de dire ici
qu’aucun des interrogateurs, même les plus sévères, ne put trouver
un seul élève en défaut sur les différentes matières enseignées dans
l’institution : toujours les élèves répondirent avec une assurance
et avec une facilité vraiment remarquable.
Le drame de Vildae, scène de mœurs espagnoles, a été joué
avec un immense succès, ce qui s’explique d’ailleurs par
l'excellence de l’interprétation. Chacun des acteurs s'est acquitté
de son rôle respectif avec une habileté qui enleva à chaque fois de
nombreux et spontanés applaudissements. Nous avons surtout remarqué
Arthur Chalifour (Vildae, père), Théodore Chalifour, (Vildae, fils),
Valmore Gauvreau, (Adolphe), Philias Lavoie, (Brûle moustache). Tous
se sont distingués et nous ne saurions pas trop à qui accorder la
palme, tant ils se sont bien acquittés, les uns et les autres, de
leurs rôles difficiles. Rien n’est plus beau, plus charmant, plus
espiègle, plus agaçant que le jeune Pierre Garon dans Ricarde.
Ajoutons aussi que M. Philias Larrivée a été désopilant dans le rôle
insensé de sergent-instructeur.
Après cette pièce délicieuse qui absorba plus d'une heure et durant
laquelle l’oreille ne pouvait se lasser d'écouter et les mains
d'applaudir, eut lieu la partie la plus importante de la cérémonie,
moment de douce jouissance pour l’élève heureux et qu’il contemple
avec un regard de convoitise qui dit toute son émulation : nous
voulons parler de la distribution des prix. Les prix furent donnés
de la main même de monseigneur Langevin. Cette séance se terminait
là. Sa Grandeur voulut se faire l’interprète du public distingué qui
assistait à cette solennité pour remercier et féliciter les élèves
qui venaient de se produire aussi avantageusement et pour les
instants agréables qu’ils nous avaient procurés.
Après Sa Grandeur, l’hon. M. U. Tessier prit la parole, et, dans une
chaleureuse improvisation fit un éloge bien mérité des avantages de
l’éducation et dit qu’il était heureux de constater combien est
relevée l'éducation que les messieurs de ce séminaire donnent aux
élèves qui fréquentent leur maison d’éducation qui peut être égalée
quelque part, mais ne saurait être surpassée par aucune autre maison
d’éducation de ce genre dans toute l'étendue du pays.
Pour notre part, nous avons été charmé de cet examen qui justifie si bien la haute réputation du Séminaire de Rimouski, et nous ne saurions trop remercier qui de droit pour la gracieuse invitation qui nous a permis d'y assister. J. W. M., 3 juillet 1870. » Fin du texte cité |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6210
6 janvier 2022
Une situation précaire
Dans son édition du 5 mai 1881, le journal L’opinion publique
publie un texte signé par un ami du Séminaire de Rimouski. Ce texte
fait suite à l’incendie de la bâtisse le 5 avril dernier.
« La bénédiction solennelle du
Séminaire de Rimouski a eu lieu le 31 mai 1876. À l'automne de la
même année, les classes s'ouvraient dans ce bel édifice construit au
prix des plus grands sacrifices. Bien qu’il ne fût pas encore
complétement terminé à l'extérieur et à l’intérieur, les élèves y
trouvaient cependant toutes les commodités nécessaires à leur santé.
Un appareil de chauffage perfectionné entretenait dans les
appartements une chaleur égale et tempérée. Un air toujours pur
circulait dans les salles et les dortoirs. À la salle d’étude et
dans les classes, chaque élève avait une chaise et un pupitre et
pouvait ainsi supporter facilement les fatigues de longues heures de
travail.
Les musées et les
bibliothèques déjà considérables étaient enrichis d'objets et
d’ouvrages précieux. Plusieurs fois aux épreuves du baccalauréat, de
brillants succès avaient couronné tant d’efforts et de dévouement et
avaient montré en même temps que les jeunes gens recevaient au
Séminaire de Rimouski une instruction aussi élevée que solide. Tout
annonçait donc un avenir prospère, lorsque le 5 du courant, un
violent incendie vint détruire en un instant l'œuvre de 14 ans de
peines et de sacrifices de toute sorte.
On ne connaît pas encore
l’origine du feu. Au moment où les directeurs de la maison en ont
été avertis, le feu était déjà répandu dans le toit du centre.
L'incendie s'est développé avec une telle rapidité que les élèves
ont eu à peine le temps de monter au dortoir et de pénétrer dans les
chambres pour sauver une partie de leur linge et de leurs livres. Il
était alors sept heures a. m.
Un quart d'heure après il
n'était plus possible d'arriver au troisième étage. Vers huit
heures, le dôme et le toit tout entier se sont effondrés. À dix
heures, il ne restait plus du magnifique Séminaire de Rimouski que
des murs calcinés, des monceaux de décombres d'où montaient encore
des spirales de fumée. Le séminaire avait un développement de 384
pieds sur 50 et 46 pieds de hauteur. La façade avait 244 pieds de
longueur avec deux ailes de 100 pieds de profondeur sur 50 de
largeur. Le corps principal avait 90 pieds de longueur.
Les pertes causées par cet
incendie s’élèvent à plus de 100 000 $. La bâtisse seule coûtait 75
000 $. Elle était assurée au montant de 25 000 $, dont 15 000 $ à la
Royale Anglaise et 10 000 $ à la Royale Canadienne. Il y avait aussi
une assurance de 4900 $ répartie sur le mobilier, les bibliothèques
et l'appareil de chauffage, etc.
Malheureusement le Séminaire a
une dette de plus de 30 000 $, de sorte que les assurances ne sont
pas suffisantes pour payer les emprunts et acheter le mobilier et
les livres qu’il faut pour continuer les cours. Le diocèse de
Rimouski, qui s'était imposé de si grands sacrifices pour construire
le Séminaire, se trouve donc aujourd’hui dans une position bien
critique. Cependant loin de se laisser abattre par le découragement,
il fait des efforts vraiment héroïques pour relever sur ses ruines
une institution qui lui est chère à bien des titres.
Tous ceux qui verront ce
qu'était le Séminaire de Rimouski il y a quinze jours et ce qu'il
est aujourd’hui, ne seront pas insensibles à un si triste spectacle
et s'empresseront de répondre à l’appel de leurs frères éprouvés et
d'écouter la prière de plus de cent jeunes gens qui leur demandent
une petite part de leurs libéralités. Les classes se sont ouvertes
le 19 du courant dans le vieux Séminaire. » (Fin du texte cité)
Note. En 1881, on compte 1417 habitants à Rimouski. |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6175
15 décembre 2021
Un comité de secours
Le journal l’Électeur du 16 avril 1881 annonce la mise sur
pied d’un comité pour reconstruire le Séminaire de Rimouski. Le feu
s’était déclaré dans le toit le 5 avril précédent et la bâtisse
était une perte totale.
« Une grande épreuve, un malheur inattendu est venu fondre sur la
petite ville de St-Germain de Rimouski. Dotée par la divine
Providence d’un évêché depuis 14 ans seulement, elle avait vu son
importance grandir, et un Séminaire s’ériger au milieu d'elle avec
l’approbation, l'encouragement et les sympathies de tout le pays.
Rien n’avait été épargné pour procurer aux élèves un enseignement
classique complet. Des musées étaient commencés et des bibliothèques
déjà considérables avaient été réunies, grâce surtout à la
générosité de plusieurs amis de la maison. L'on venait de compléter
un système de chauffage perfectionné, si important pour la santé des
élèves et l'éloignement du danger d’un incendie. Ce n’est pas non
plus par cette voie qu’est arrivé le sinistre. La Divine Providence
a permis que le feu ait pris dans les toits sans qu'on en connaisse
la cause et sans qu’il ait été possible d’arrêter ses ravages
destructeurs.
Voilà donc une jeune institution paralysée et arrêtée dans sa
marche : obligée de recommencer tous les efforts si laborieux de la
formation matérielle, elle a droit d’attendre les encouragements de
tous les amis de l’éducation en ce pays. Mais les citoyens de
Rimouski sentent que c’est à eux de prendre l'initiative et
d’exposer la situation.
Il
y avait, il est vrai, des assurances sur la bâtisse et le mobilier
pour 29 000 piastres mais cette somme ne couvre pas le montant qui
était encore dû sur les emprunts, tandis que la perte totale s’élève
à environ 100 000 $.
L’institution espère certainement rencontrer ses engagements envers
ses prêteurs : ce n’est tellement pas là que se trouve la grande
difficulté. Il s’agit de continuer l’œuvre essentielle de ce
Séminaire dont le diocèse ne peut se passer pour former la classe
instruite, pour recruter son clergé.
Loin de perdre courage, les directeurs se sont déjà mis à l’œuvre
pour ouvrir de nouveau leurs classes dans un local provisoire et
répondre ainsi à l’attachement de leurs élèves qui n'attendent que
le de ralliement.
C’est à nous citoyens de Rimouski, nous l’avons senti, d’obtenir des
sympathies et de la bienveillance du public canadien les moyens de
seconder le zèle d’hommes voués de toute leur âme à l’instruction de
la jeunesse. Nous voulons les aider à relever les ruines de leur
chère maison : nous y sommes poussés et par nos propres sentiments
d’attachement à un établissement si avantageux, et par les profondes
marques de bienveillance, dont la corporation du Séminaire est
l’objet en ce moment de la part du clergé, de tous les citoyens sans
distinction et en particulier des anciens élèves, déjà répandus dans
tous les rangs la société.
Nous faisons donc un appel en faveur de cette maison à tous les amis
de l’éducation et de l'instruction chrétienne, leur demandant une
petite part des libéralités qu'ils répandent avec tant d’abondance
dans le sein des pauvres et qu’ils ont souvent mises entre les mains
des instituteurs de la jeunesse. (…) » (fin du texte cité)
Les membres du comité central de
secours sont :
- Président : Mgr Jean Langevin,
évêque de Rimouski
- Secrétaire : C. A. Charbonneau,
chanoine, secrétaire de l’Évêché
-Trésorier : P. J. Saucier,
chanoine, procureur du Séminaire
- Edmond Langevin, vicaire général
- L. J. Langis, directeur du
Séminaire
- A. Audet, curé de Rimouski
- P. Sylvain, vicaire de Rimouski
- P. L. Gauvreau, écuyer, maire de
Rimouski. - Suivent 12 autres noms d’hommes qui ont le titre d’écuyers. |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6155
3 décembre 2021
Un collège qui se démarque
Dans l’édition du 7 août 1883 du journal l’Étendard, un
correspondant qui signe Frontenac loue Mgr Langevin pour son
Séminaire et trouve qu’il y a trop de collèges classiques au Québec.
Voici ce texte :
« Au nombre des grandes œuvres de la ville est
le Séminaire et le Collège de Rimouski. Après d'héroïques
sacrifices, Sa Grandeur Mgr Langevin, premier évêque de ce diocèse,
était parvenu à faire ériger une bâtisse magnifique pour cette fin.
Malheureusement, le feu, comme la foudre, arrive à l'improviste. En
un instant, le prix de tant d'efforts était détruit par les flammes.
Ce malheur aurait pu faire fléchir des âmes moins fortement trempées
que celle de Sa Grandeur. Le diocèse est pauvre, les besoins sont
pressants, les œuvres multiples, le courage d'un évêque est
au-dessus de tout. La congrégation Notre-Dame consent à vendre la
magnifique maison qu'elle venait de faire ériger ici ; le collège
s’y installe et continue à répondre les bienfaits d’une éducation
solide et saine dans tout le pays environnant.
Le supérieur actuel, M. le chanoine Langis, est l’un des hommes les
plus distingués de notre époque. Ses vues larges, sa science
certaine, son jugement solide, son esprit conciliant, le rendent
souverainement précieux dans un diocèse. Mais, s'il nous était
permis, à propos de collèges, de faire une remarque, (non à cause de
celui de Rimouski qui est nécessaire au diocèse), nous dirions que
les maisons de haute éducation sont bien trop nombreuses, et
qu’elles constituent en quelque sorte un danger national en
permanence.
Que de pauvres jeunes gens enlevés à l’agriculture sont, à cause de la proximité d'un collège, jetés dans les professions libérales. Hélas! la plus triste des misères est la pauvreté en habit noir. Nos villes regorgent d'hommes de profession. Les médecins n'y ont plus de malades, ni les avocats de causes. Alors c’est la misère, la plus triste de toutes. C’est le désespoir qui se manifeste par l’ivrognerie souvent. La cause a été la facilité avec laquelle l'on se procure une éducation classique. Je livre à la méditation de qui de droit cette proposition. » (Fin du texte cité) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6130
18 novembre 2021
L’incendie du deuxième Séminaire
Dans l’édition du 9 avril 1881, le journal Le Courrier du Canada
publie un texte écrit par un témoin qui raconte comment s’est
déroulé l’incendie du deuxième Séminaire de Rimouski. Par sa carrure
et sa modernité, cet édifice était considéré comme l’une des maisons
d’enseignement les plus magnifiques au Québec. Voici le texte :
« La divine Providence, comme vous le savez, vient d’éprouver (5
avril 1881) bien cruellement la ville et le diocèse de Rimouski.
Pour exciter davantage les sympathies en faveur des directeurs de
cette maison, je vais essayer de vous donner une description aussi
fidèle que possible de cet incendie qui a détruit les fruits de si
pénibles labeurs.
Le feu, dont on ignore l’origine, a commencé sur le toit, entre les
cheminées du centre, à l’ouest, et le dôme. Il y avait déjà plus de
2 heures que l’élément destructeur faisait son œuvre, lorsque des
servantes qui étaient dans les dortoirs ont couru avertir M. le
directeur. Au même instant, les cloches de la cathédrale
annonçaient aux citoyens de Rimouski qu’un grand malheur les
menaçait.
À 7
h
¼ a. m. les trois quarts du toit étaient envahis par le feu ; la
fumée se répandait déjà dans les dortoirs et même dans le troisième
étage. Le Séminaire brûle, le Séminaire est en feu, tel était le cri
général ; ce cri sinistre retentit aussi aux oreilles des
ecclésiastiques et des écoliers qui étaient à prendre leur déjeuner.
Tous se levèrent sans désordre, ne croyant pas encore au danger
auquel ils étaient exposés, et coururent sauver leur linge et leurs
livres.
La scène qui se passa alors défie toute description. À travers les
pétillements de la flamme, les craquements des supports du toit déjà
à moitié consumés qui cèdent sous le poids qu’ils ne peuvent plus
porter, on entend du dehors des cris, des gémissements. Les
surveillants encouragent ceux qui se désolent et sacrifient ce
qu’ils possèdent pour prévenir tout accident.
Quelques petits écoliers affolés par la peur tentent de se jeter par
les fenêtres ; d’autres, plus maîtres d’eux-mêmes, lancent du haut
en bas leurs coffres et leurs matelas. Ceux-ci, malgré l’activité
prodigieuse du feu, prennent le temps de mettre leurs meilleurs
habits, leurs chaussures neuves, et réussissent ainsi à sauver ce
qu’ ils ont de plus précieux. Ceux-là, hors d’eux-mêmes, laissent
les objets les plus importants pour se charger d’effets inutiles ou
sans valeur.
Les corridors, les escaliers, sont alors encombrés de coffres, de
meubles ; on appelle au secours, on se bouscule : cependant, malgré
ce tumulte, la main de Dieu écarte les obstacles, et chacun
s’échappe sain et sauf.
Dans le grand Séminaire, le spectacle n’est pas moins triste. M. le
directeur, après avoir été averti, monte aussitôt à sa chambre, qui
est au troisième étage, prend une boite, quelques habits, et court
chercher le procureur qui était au Couvent de la congrégation. À son
retour, avec l’aide de M. le préfet des études, il sauve les saintes
Espèces, les vases sacrés, et charge M. le curé d’aller les déposer
à la chapelle du couvent de la congrégation. Les religieuses et
leurs élèves reçoivent en pleurant le Maître de l’univers qui, Lui
aussi, fuit devant le feu dévastateur.
Les ecclésiastiques ont à peine le temps d’entasser dans leurs
valises ce qui leur tombe sous la main, que déjà la fumée les
suffoque. Le feu était alors répandu dans tout cet étage, et ce
n’est qu’ avec peine et au péril de leur vie, que ces infortunés
ecclésiastiques ont pu descendre dans les étages inférieurs ne
sauvant des flammes qu’une bien petite partie de leur linge et de
leurs livres.
L’incendie s’étant déclaré dans la partie supérieure du Séminaire,
il a été assez facile à ceux qui habitaient le deuxième et le
premier d’arracher aux flammes ce qu’ils avaient de plus précieux.
Mais, malgré tous les efforts et la bonne volonté des élèves et des
citoyens, que de petits trésors amassés avec peine, que de
collections de toutes sortes recueillies avec patience, que de
présents généreux ont été détruits en un instant.
Vers 8 h, le dôme s’est effondré tout entier au centre de l’immense
brasier. Les flammes poussées par le vent couraient en
tourbillonnant dans les corridors et
les salles, faisaient voler les fenêtres et éclater les tubes de fer
d’où la vapeur comprimée s’ échappait en sifflant comme une fusée
qui s’élance dans l’ air.
À 10 h, tout était consumé : du magnifique Séminaire de Rimouski, il
ne restait plus que les murs noircis par la fumée, calcinés par
l’ardeur du feu qui a dévoré jusqu’au plus petit morceau de bois.
Tous ceux qui s’intéressent à la cause de l’éducation comprennent
combien ce malheur est grand, et combien sont dignes de la sympathie
générale ceux qui en ont été les victimes infortunées.
*La photo appartient à la Corporation du Séminaire de Rimouski. |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6110
6 novembre 2021
Louanges de Georges Potvin
Dans son édition du 13 février 1886, le journal La Justice
loue la contribution gigantesque du Rév. Georges Potvin dans la
naissance du collège classique de Rimouski et souhaite que le titre
de fondateur ne lui soit pas enlevé. Voici ce texte :
« Devenu prêtre, il fut envoyé vicaire à Rimouski, où feu M. Forgues
était alors curé. Prévoyant que Rimouski deviendrait dans un avenir
rapproché, un siège épiscopal, il travailla sous les influences de
la grâce à y fonder un collège classique. Ce n'était pas chose
facile ! Il fallait vaincre l'apathie des uns, surmonter les
obstacles des autres, créer les ressources nécessaires pour
maintenir une maison de haut enseignement, faire face à toutes les
difficultés croissant avec les jours. Et pour lutter contre tant
d’éléments contraires, le jeune prêtre n'avait que son zèle, mais il
en était saisi, possédé, dévoué ; il en avait les élans, les éclats
et les sacrifices.
Dès quatre heures du matin, il était à l’œuvre. Ses exercices de
piété auxquels il était très fidèle, même au milieu des plus grandes
fatigues, commençaient une journée si matineuse ; venait ensuite
cette dépense d'énergie et de dévouement qui semblait ne devoir
jamais l’épuiser. Il fallait pourvoir à la nourriture des élèves,
régler tout ce qui avait rapport à l'économat de la maison et
recommencer chaque jour ; car dans celte pauvre institution personne
n'était assuré du lendemain. De là, mille sujets d’inquiétude que
surmontait toujours sa confiance sans bornes en celui qui donne aux
oiseaux du ciel leur nourriture. Il présidait aux exercices des
élèves dont il était le directeur et en même temps le professeur
dans différentes classes, la faiblesse de ses ressources ne lui
permettaient pas de salarier un grand nombre de professeurs.
N'écoutant que sa sollicitude pour cette maison naissante, qui ne
vivait que par lui, il conservait ses quelques moments de loisir à
travailler au colombage et à préparer lui-même les divers
appartements du vieux collège. Plusieurs générations d’élèves s'y
sont succédé et l’œuvre de ses mains demeure encore. Ainsi pendant
près de quatre ans, M. Potvin fut à la fois économe, procureur,
professeur, directeur et menuisier.
Pour économiser le bois, il ne chauffait pas sa chambre au milieu de
l'hiver, et ceux qui habitaient le collège à cette époque savent
seuls ce qu’on y souffrait de froid. Aussi y contracta-t-il le germe
de la maladie qui l'a probablement conduit au tombeau dans la
vigueur de l'âge (51 ans). Comment se fait-il qu’il ait pu résister
si longtemps à des travaux multiples, lui qui était d'une complexion
faible ? Ah ! c'est que le caractère dominant de cette riche nature
était le zèle, qu'elle en était pour ainsi dire consumée ! Aussi
elle vivait de sa flamme et ne se consumait que pour revivre. (…) Mais dans notre malheureux siècle si tristement célèbre par l'orgueil doublé d'égoïsme, qui règne sous toutes ses formes, et recherche sur tout l'isolement, les caractères forts et généreux sont rares, et l’on ne comprend pas toujours ce que vaut et ce que coûte une vie d'holocaustes sans réserve et de tous les jours, dont Dieu seul connaît toute l'étendue et tout le prix. Le regretté M. Potvin fut une de ces victimes mal appréciées, et on lui contesta, il y a quelques années le titre de fondateur du collège classique de Rimouski, érigé depuis en Séminaire par Mgr Langevin. Il subit, sans réclamer lui-même, l'opinion avec courage, mais sa douleur fut sans doute profondément sentie : on lui enlevait l’œuvre de ses jours. (…) » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6090
24 octobre 2021
Distribution des prix en 1934
En
juin de chaque année au Séminaire de Rimouski, la distribution des
prix est précédée d’un spectacle et, pendant longtemps les
finissants y sont invités à dévoiler leur choix de carrière. Le
Progrès du Golfe du 22 juin 1934 publie un compte-rendu de cette
double cérémonie.
« Lundi soir le 18 juin, avait lieu au Séminaire la distribution
solennelle des prix. M. le chanoine Lionel Roy, supérieur,
présidait, assisté de Mgr S.-J. Langis, V. G., Mgr J.-A. Verreault,
curé de l’Isle- Verte, et M. l’abbé Georges Dionne, préfet des
Études. Il y avait foule.
La
séance s’ouvrit par l’exécution d’un morceau de piano « Rigodon ».
L’exécutant, M. L.-P. Roy, vient d’obtenir son diplôme de grade
supérieur au Conservatoire de Musique de Québec. On procéda à la
distribution des prix. MM. L.-P. St-Onge et Maurice Tremblay lirent
le palmarès. En guise d’intermède, la Chorale des élèves chanta avec
maîtrise « La Laitière et le Pot au lait », sous l'habile direction
de M. l'abbé Joseph Lévesque. On passa ensuite à la distribution des
prix spéciaux, et à la collation des diplômes des élèves du cours
commercial.
Puis, ce fut l’émotionnante cérémonie de la prise des rubans par les
finissants du cours classique, qui révèlent à ce moment le choix de
leur vocation et de leur carrière, — et le discours d’adieu à l'Alma
Mater par M. Bertrand Dionne, fils de M. le notaire G.-L. Dionne,
d’Amqui, qui s’acquitta éloquemment de ce pieux devoir, au nom de
tous ses condisciples de la classe de Physique.
Voici comment se fit la prise des rubans par les 18 Finissants:
Rubans blancs (théologie, clergé
séculier) : A. Anctil, de Rivière-Blanche, B. Bérubé, de
Trois-Pistoles, J.-G. St-Pierre, de St- Paul de la Croix, L. Dion,
de St-Arsène, M. Roy, de St-Simon, J. Laurier, de St-Clément, M.
Doran, de Rimouski.
Rubans crème (clergé régulier) : H.
Pelletier, de St-Louis du Ha! Ha! et H. D’Amours, de Trois-Pistoles,
chez les Pères Blancs d’Afrique ; R. Turbide, de Lac-au-Saumon, chez
les Dominicains.
Ruban violet (Missions étrangères,
Pont-Viau) : M. Michaud
Ruban vert (droit) : J.-P. Tremblay
de Luceville.
Ruban vert et jaune (Droit et
sciences sociales) : L. Langlois de Ste-Anne des Monts et D. Asselin
de Rimouski.
Ruban rouge (Médecine) : M.-L.
Belles-Isles, de St-Fabien.
Ruban rouge et noir (Pharmacie) :
Bertrand Dionne d’Amqui.
Ruban rose (Génie forestier) : L.
Castonguay, de St-Louis du Ha! Ha!
Ruban bleu (École normale
supérieure). L. Saindon, Notre-Dame du Portage.
Au
discours d’adieu, M. le supérieur répondit par une intéressante
allocution, au cours de laquelle il exprima ses meilleurs souhaits à
ceux qui quittent leur Alma Mater et d’excellents conseils pour les
vacances à tous. De la salle des fêtes, on se transporta ensuite à
la chapelle pour la Bénédiction du T. S. Sacrement et le chant du Te
Deum.
Après cette dernière cérémonie, tandis que les élèves des autres classes prenaient le chemin du dortoir pour la nuit, les finissants se rendirent au réfectoire où le Séminaire leur avait fait servir un excellent réveillon, et de là à la salle du cercle St-Joseph où ils firent une touchante et ultime réception à leurs professeurs. Ils furent ensuite reçus à la résidence de M. l’avocat Asselin, père de M. Dérome Asselin, pour leur « veillée d’armes » … avant la séparation. » (Fin du texte cité) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6070
12 octobre 2021
Carnet d’un finissant
Dans son édition du 23 juin 1916, le Progrès du Golfe publie
les propos d’un finissant du Séminaire de Rimouski sous le
pseudonyme d’Olim Meminisse :
« Hier, c’était la sortie. Pour mes condisciples et pour moi, la
sortie définitive … Que de fois, au cours de mes études, j’avais
désiré cette heure rayonnante ; et que j’enviais, à chaque fin
d’année, les finissants transfigurés en hommes par
l’abandon de l’uniforme collégial, et par les beaux habits neufs
qu’il faut avoir pour s’embarquer sur la mer du monde.
Faut-il donc que la nature humaine soit essentiellement mouvante !
que la réalisation des plus chers désirs ne soit qu’un aliment aux
feux brûlants dont les vains souhaits et les éphémères espérances
consument le cœur !
Aujourd’hui, tout me semble changé. La vie ne m’apparaît pas sous le
même angle ; et les couleurs troublantes du prisme sous lesquelles
je voyais les hommes et les choses ont la pâleur des morts.
Ces jours derniers, en jetant au fond de mes malles les bouquins sur
lesquels j’ai peiné, j’ai retenu entre mes mains le Virgile
que je tiens d’un ami. Et j’ai voulu relire quelques vers des
Géorgiques : « Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram vertere
… »
Il
a fallu que je m’arrête après deux lignes pour essuyer une larme
chaude sur ma joue … Elles se sont insidieusement emparées de nous,
ces vieilles choses banales : cette larme qui tombe m’en convainc
mieux que toute l’expérience des siècles et des sages.
L’amertume coule à larges bords, semble-t-il, à la distribution des
prix si joyeuse naguère. Et n’est-il pas d’une sanglante ironie que
la musique exécute des menuets galants et des intermezzi
rustiques en ces heures sombres ! N’est-il pas de mauvais goût
extrême que des yeux et des lèvres continuent de sourire doucement
quand la classe qui s’en va jeter à l’Alma Mater son adieu et son
amour. Ah ! Ils ne finissent pas, eux. Elles ne finissent pas, elles
; car autrement leurs regards seraient voilés, leurs lèvres
frémiraient nerveusement en balbutiant des syllabes douloureuses, et
leurs visages et leurs âmes comme les nôtres seraient enveloppés de
deuil.
La
nuit s’achève. Dernière nuit au dortoir immense et familier, où nos
têtes ont si longtemps dormi, entourées de tous côtés de têtes
chères. Ai-je sommeillé ? Ai-je rêvé ? Je l’ignore. Mais j’ai la
conviction que les souvenirs ne s’évoquent ni si fidèlement ni si
méthodiquement dans le sommeil et dans le rêve. Si rêve il y a eu,
c’était le retour au grand dortoir, en troupes diaphanes et
capricieuses, tels des lutins de légende, des milliers de rêves
envolés, que nos imaginations façonnaient dans leurs élans de
frénésie juvénile. Ils reviennent à mon chevet, ces rêves chers,
pour me rappeler qu’une partie notable de ma vie, et la plus
heureuse sans doute, ne reviendra plus …
La
cloche sonne le réveil. Le Deo Gratias de toutes les
allégresses retentit en clameur. Et dans le cri d’enthousiasme qui
jaillit des poitrines vibre la joie sans crainte des lendemains.
Ces cris me font mal. Je voudrais être mille mains pour étrangler
d’un seul coup les gorges joyeuses … Quoi ! Le fils se réjouit-il de
quitter l’étreinte chaude et amoureuse de sa mère ?
Nesciunt quid faciunt. Ils ne savent ce qu’ils font : ils le sauront trop tôt, hélas !
Viendra le jour où les ans, comme les vagues qui rejettent les
débris des naufrages, les rejetteront dans la banalité du monde d’où
nous venons. À cet instant se dressera devant leurs yeux, ainsi
qu’il nous apparaît à nous-mêmes, le problème angoissant d’une vie
véritablement utile et bonne, de la lutte pour le bien, des malheurs
qui traversent les existence les plus fortunées ; et, d’un autre
côté, se résumeront comme ils se résument aujourd’hui pour ceux qui
s’en vont, les joies et les bienfaits inappréciables d’une formation
solidement chrétienne, d’une éducation classique imprégnée du
lait de l’humaine tendresse, du dévouement sacerdotal de maîtres
désintéressés, d’amitiés sans dols, d’heures sans regrets, de
plaisirs sans souffrances.
Et c’est tout ce que je laisse, tout ce que je quitte, moi, finissant de 1916 » (Fin du texte cité) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6045
27 septembre 2021
Séance du 22 mai 1912
Dans son édition du 24 mai 1912, le Progrès du
Golfe fait le compte-rendu d’une séance académique au Séminaire
de Rimouski :
« La Vie écolière publiée au Séminaire rapporte ce qui suit
au sujet de la belle et intéressante séance académique, dramatique
et musicale à laquelle nous avons eu le plaisir d’assister en grand
nombre mercredi soir.
Comme par les années passées, hier le 22,
eut lieu une soirée littéraire et musicale en l’honneur de Mgr
l’Évêque de Rimouski. C’est aux applaudissements et au son doux et
harmonieux de la fanfare que Sa Grandeur fit son entrée dans la
salle.
Après ces accents pleins de mélodie qui touchent l’âme humaine, M.
St-Pierre fit entendre sa voix émue dans une allocution à Mgr.
Pendant que tous sont attentifs apparaissent MM. G. Rioux et E.
Latulippe qui chantent un duo historique. Nous étions sous le charme
des accents que nous venions d’entendre lorsque M. Belzile commença
la lecture de son rapport académique. Il ne fut pas aussi ennuyeux
qu’il voulait le faire croire, mais fut certes un critique sévère.
Plusieurs lui en veulent.
Bah ! il a peut-être dit la vérité ; pourquoi lui en garder rancune.
« Qui bene amat, bene castigat » comme il nous l’a rappelé. S’il
vous aime, le bonhomme est moins méchant qu’il ne semble,
conservez-lui votre amitié !
M. Georges Dionne donna ensuite lecture d’un travail fort goûté du
public instruit. » (Fin de texte de la Vie écolière)
Le Progrès du Golfe a publié dans son dernier numéro
l’intéressant programme qui a été parfaitement exécuté à la séance
de mercredi par les élèves de notre Séminaire. Nous ajouterons à ce
qu’écrit la Vie écolière une mention spéciale de quelques
articles du programme qui furent des mieux réussis et fort goûtés de
l’assistance. Par exemple, la lecture des Petites cloches rouges
par un jeune élève, M. Pierre Smith, la déclamation d’une jolie
pièce par le petit Séraphin Vachon, le chant de La cigale et la
fourmi (grand chœur) rendu par l’Union Chorale du Séminaire,
avec délicieux solos par Séraphin Vachon et Louis-Philippe Couture,
et enfin l’excellente interprétation d’un magnifique opéra comique
Le 66 par MM. Georges Rioux, Jean-Marie Roussel et Alphonse
Miville qui ont obtenu un brillant succès dans la magistrale
exécution de leur rôle.
La fanfare Ste-Cécile, comme toujours en de telles circonstances, a
fait les frais de la partie musicale de la manière la plus agréable
et la plus parfaite.
Mgr l’Évêque a terminé cette séance par une éloquente allocution,
remerciant les élèves et leur prodiguant les plus sages conseils.
Au cours de la soirée, sept élèves des classes supérieures furent promus, en présence de Sa Grandeur, au grade d’académiciens : MM. Joseph Dumas, Émile Côté, Louis-de-Gonzague Fortin, Adélard Leblanc, Joseph Chénard, François Létourneau, Alexandre Chouinard. » (Fin du texte du Progrès du Golfe) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 6025
15 septembre 2021
Les débuts du collège (1862-1882)
Dans son édition du 2 février 1882, le Courrier du
Canada publie un texte fort précieux écrit par
un des premiers élèves du collège classique de
Rimouski :
« Il y a vingt ans, le 2 février 1862, les classes du Collège de
Rimouski s’ouvraient pour la première fois dans la sacristie de
l’ancienne église avec la permission de Mgr l’Archevêque de Québec.
Cet anniversaire assez remarquable pour ne pas le laisser passer
inaperçu, rappellera sans doute de nombreux souvenirs à ceux qui ont
vu les commencements et suivi les progrès de cette maison
d'éducation.
Nous n’avons pas l’intention de faire ici l’histoire du Collège de
Rimouski ; elle n’est pas d’une époque si reculée qu’elle soit déjà
tombée dans l’oubli. À cette occasion, nous nous contenterons de
dire que, comme la plupart des collèges fondés dans la Province de
Québec, celui de Rimouski a passé par la pauvreté et la souffrance.
Dirigée pendant plusieurs années par le Révérend M. Georges Potvin,
homme d’une puissante énergie et d’un dévouement sans bornes, cette
institution naissante a triomphé des obstacles nombreux qui
s’opposaient à son développement. Soutenu dans ses épreuves par des
amis généreux, le Collège de Rimouski, malgré le manque de
ressources, s’est assis sur des bases solides et a poussé dans le
sol de fortes et vigoureuses racines.
Dieu qui avait des vues particulières sur cette maison semble en
avoir dirigé lui-même la marche et les progrès. Quelques années
s'étaient à peine écoulées depuis son installation dans la vieille
église, que déjà le Collège de Rimouski avait reçu une organisation
complète des mains de Mgr l’Évêque de Tloa (et administrateur de
l’archidiocèse de Québec) qui, pour répondre à de pressantes
requêtes avait ajouté l’enseignement du latin et du grec à
l’enseignement commercial et agricole, le seul que l’on avait donné
pendant plusieurs années.
Dans sa sollicitude pour cette maison destinée à devenir les plus
chères espérances d’un diocèse nouveau, Mgr Baillargeon y envoyait
au bout de quelques années trois prêtres et quatre ecclésiastiques.
Ainsi favorisé par la Divine Providence, dirigé par des prêtres
éclairés, et pleins de zèle, le Collège de Rimouski était dans un
état prospère lorsque le diocèse fut érigé en 1867. Dieu avait
disposé les choses de telle sorte qu'à son arrivée dans son nouveau
diocèse le premier Évêque de Rimouski y trouvait un Collège
commercial et classique régulièrement organisé qu'il prit sous sa
haute protection en en faisant un peu plus tard son Séminaire
diocésain. C’était couronner dignement une œuvre qui avait déjà fait
un bien considérable dans cette partie du pays.
Au mois de septembre 1876, les élèves firent leurs adieux au vieux
Séminaire et entrèrent dans le séminaire neuf dont la bénédiction
solennelle avait eu lieu avec une pompe extraordinaire le 31 mai de
la même année. On se promettait une vie longue et prospère dans ce
bel édifice construit par les mains de la charité lorsque le 5 avril
dernier le feu détruisit toutes ces légitimes espérances. Tout
semblait perdu. Mais, Dieu dont les desseins sont impénétrables,
avait tenu en réserve le vieux séminaire. Quinze jours après, les
élèves venaient demander l’hospitalité à ces vieux murs témoins des
épreuves et des gloires du passé.
Aujourd’hui, 2 février 1882, les élèves sont encore dans cette
maison dans laquelle nous sommes entrés pour la première fois le 2
février 1862. À l’occasion de ce vingtième anniversaire, nous
offrons à notre Alma Mater nos vœux les plus sincères pour sa
prospérité et notre reconnaissance la plus vive pour l’éducation et
l’instruction que nous y avons reçus.
Nous souhaitons ardemment que le concours généreux des amis de l'éducation lui aide à construire de nouveau un édifice qui soit plus en rapport avec le rang distingué qu’elle occupe parmi les autres Séminaires et collèges de la Province de Québec. |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5995
15 juin 2021
Fondation d’une association d’étudiants
Jusqu’en 1964, au Séminaire de Rimouski, chaque classe se dotait d’un
conseil qui devait représenter les confrères du groupe auprès des
autorités. Il y avait généralement très peu de coordination entre les
différents conseils.
Il y avait aussi, certaines années, un comité qui était composé des
présidents des diverses associations. L’objectif était de proposer à
l’ensemble des élèves des activités qui pouvaient dépasser le mandat de
chaque association : le tout pour améliorer la vie étudiante.
Dans son édition du 25 décembre 1964, sous le titre
Les étudiants s’unissent,
le Progrès du Golfe écrit : « À
la suite d'une réunion de fondation, tenue le lundi 21 décembre, à
Rimouski, l’Association Générale des Étudiants du Séminaire de Rimouski
(l’AGESR) est maintenant formée et des élections aux postes du comité
exécutif ont immédiatement été tenues.
Le premier président sera donc M. Jean Bérubé, le vice-président interne
Yvan Labrie, le vice-président externe Jacques Lagacé, le secrétaire
Jean-Yves Leblanc, le trésorier Marc-André Dionne, et le conseiller
juridique Ghislain Morneau.
Cent deux étudiants, du pavillon de Philosophie du Séminaire, s’étaient prévalu de leur droit de vote. Instituée pour donner à leur groupe plus de « poids » au sein de cette institution d'enseignement, l’AGESR se propose de travailler au bien général des étudiants. »
Source de la photo : Le Progrès du Golfe |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5970
30 mai 2021
Discours de Guillaume Dionne
Pendant longtemps au Séminaire de
Rimouski, la coutume voulait qu’à la distribution des prix en fin
d’année ou avant, le président des Finissants fasse un discours de
remerciements à l’intention des professeurs et des autorités de
l’institution. Cette année-là, en 1917, c’est Guillaume Dionne (1) qui a
pris la parole au nom de ses confrères. Son discours émouvant a été
publié dans le Progrès du Golfe du 29 juin 1917. En voici de
larges extraits :
« M. le Supérieur, Mesdames, Messieurs,
Avant que nous quittions cette salle pour
aller chanter le Te Deum de la reconnaissance, avant que nous quittions
à jamais notre Alma Mater et que se close pour nous une période très
importante de notre vie, permettez que nous consacrions les derniers
moments de cette soirée à l’expression des sentiments qui remplissent
notre âme.
L’heure de notre dernier départ a sonné.
Poussés par la succession mouvante et montante des générations qui
viennent chacune à leur tour croître et se développer sous le soleil pur
et rayonnant de l’éducation chrétienne, nous sommes arrivés à la
dernière étape. Bientôt, nous serons rejetés hors de notre collège, de
notre nouvelle famille, comme jadis nous contribuions par un destin
éternel à rejeter les classes qui nous précédaient et qui nous traçaient
le chemin dans la voie des exemples comme dans celle des adieux. »
Le futur abbé Guillaume
Dionne continue en exprimant ses inquiétudes sur l’avenir des étudiants
de son groupe dans le contexte où la première guerre mondiale continue à
faire des ravages en Europe et qu’au Québec on est en pleine crise de la
conscription. Son texte est teinté de cette réalité. Il continue :
« Nous partons donc. Nous partons à une heure
particulièrement solennelle et tragique. La question troublante se
pose : De quoi demain sera-t-il fait pour nous ? … Et quelle perspective
pour des jeunes hommes de vingt ans, si haute que soit leur âme façonnée
de christianisme et de la moelle des classiques de tous les âges, que
d’avoir dès leurs débuts à marcher à travers les difficultés
inextricables qui se présentent, que d’avoir à partager dès la première
heure la trop lourde croix qu’on prépare à la patrie canadienne ! Qui
peut affirmer en effet, à l’heure sombre où nous vivons, qu’un lendemain
néfaste ne viendra pas transformer les sacrifices généreux et souvent
bien pénibles de nos bons parents, le dévouement de nos maîtres, les
efforts de nos longues années d’études en sang humain versé sur le sol
de l’Europe et de l’Asie pour que fleurisse la liberté … des autres ?
Qui peut l’affirmer ? » (…)
« Mais si l’avenir est sombre, nous devons ajouter à
la gloire de notre cher Séminaire, à la gloire de nos chers maîtres que
les ressources dont nous sommes pourvus pour la vie quelle qu’elle soit,
sont un gage précieux et rassurant. Une formation intellectuelle qui
nous a grandis, une formation morale qui nous a raffermis et qui nous
empêche de flotter à tout vent, voilà les armes précieuses que l’Alma
Mater nous a mises entre les mains avec la sollicitude amoureuse d’une
mère.
M. le Supérieur, ceux qui s’en vont tiennent à remplir
solennellement leur devoir de justice envers les prêtres qui se sont
consacrés, avec quelle abnégation vous le savez, à forger pour nos mains
ces armes chrétiennes, nouvelles Durandals (2). » (…)
« Bien chers camarades, les jours heureux de notre vie commune sont
terminés. Nous avons pendant plusieurs années partagé le même toit, nous
avons prié dans la même chapelle, nous avons partagé les mêmes classes,
les mêmes livres, les mêmes idées, les mêmes jeux, comme des amis, comme
des frères. Ce toit béni, cette bien-aimée chapelle, ces livres à la
science débordante, ces idées qui s’ébauchent et se forment ne nous
appartiendront plus. Nous entrons dans le rang banal pour y remplir le
devoir qui nous sera tracé, pour servir non à la façon des esclaves,
mais comme des hommes qui connaissent le prix de la vie et de la
liberté. (…)
Nous ne doutons pas que vous serez heureux de demander
à la douce Vierge de la Congrégation d’envelopper de sa tendresse ainsi
que de l'ample manteau d’azur qui la recouvre ceux que l’Alma Mater ne
pourra plus protéger et guider de sa main maternelle.
Donc à tous notre adieu. Adieu à nos bien-aimés
directeurs, à nos maîtres dévoués, adieu à nos chers camarades. Adieu à
notre collège. Où nous irons et toujours, que la guerre « détestée des
mères » nous ait marqués du doigt pour les tueries géantes, que demain
nous revenions dans l’ombre auguste de l’autel nous préparer pour les
moissons immenses du Maître, ou qu’étudiants de l'Université nous nous
exercions par l’acquisition de la science et des diplômes au service de
la patrie canadienne, partout et toujours, en un mot, son souvenir avec
douceur hantera notre pensée, son amour remplira notre cœur.
Une brigade irlandaise fameuse avait jadis écrit sur
son drapeau cette noble devise : Semper et ubique fideles. Nous en
faisons la nôtre : Toujours el à jamais fidèles. À la vie, à la mort !
! »
(1) Guillaume Dionne est natif de Trois-Pistoles. Il est ordonné prêtre
en 1921. À partir de 1924, il occupe de nombreuses fonctions au
Séminaire de Rimouski. Il est notamment professeur de mathématiques et
de physique. Il est économe (1931-1941), assistant-procureur (1941-1943)
et procureur (1943-1964). Il est nommé chanoine en 1964. En 1917, quand
il était finissant, il a reçu le prix Langis, étant le premier de sa
classe au baccalauréat.
(2) Nom de l'épée appartenant au chevalier Roland, un personnage de la littérature médiévale. |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5945
15 mai 2021
Le premier conventum du 98e cours
Au Séminaire de Rimouski, la tradition voulait qu’un premier conventum
ait lieu à la fin des études de lettres, soit deux ans avant la fin du
cours classique. Dans son édition du 12 juin 1959, le Progrès du
Golfe publie un compte-rendu du premier conventum du 98e
cours.
« Le 27 mai dernier, les Rhétoriciens du Séminaire de Rimouski faisaient
leur premier conventum à la Pointe-Santerre au Bic. Le départ de
l'Alma Mater s’effectua vers une heure par une température excellente.
Le trajet en autobus fut très animé.
Les sportifs avaient des gants, des balles ainsi qu’un jeu de
ballon-volant. Les plus romantiques se promenèrent sur la grève ou dans
le bois. Quelques musiciens organisèrent même une danse en plein air. À
marée haute, vers quatre heures, on put faire des tours en chaloupe sur
la mer calme et même prendre une « saucette ».
Plusieurs des professeurs, anciens et actuels, visitèrent les
pique-niqueurs. On en profita pour se rappeler les bons moments du cours
de lettres. M. l'abbé Georges Beaulieu, professeur principal, passa tout
l’après-midi avec les rhétoriciens, les assistant de ses conseils
judicieux et de son entrain.
Vers quatre heures, les estomacs commencèrent à crier famine, mais les
vivres ne manquaient pas : les crêpes traditionnelles et substantielles.
Le retour se fit vers sept heures. Cette journée mémorable se termina par une veillée intime. Déjà, on pense au prochain conventum qui aura lieu dans dix ans. Aurons-nous bien changé ? En attendant, vive la Rhéto. » |
|
| Retour | Accueil |
|
#
5910
24 avril 2021
Jubilé d’or de la Vie écolière
Dans son édition du 10 mars 1961, le journal Le Progrès du Golfe
publie un article intitulé « La Vie écolière du Séminaire de
Rimouski compte 50 ans d’existence ». Voici ce texte :
« Pour souligner cet événement, plutôt rare dans une maison
d’enseignement québécoise, les autorités ont publié un numéro-souvenir
où les écrits des anciens, exprimant leurs opinions et ressassant leurs
souvenirs, voisinent avec ceux des étudiants actuels, les collaborateurs
plus réguliers de la Vie écolière 1960-61.
L’archevêque de Rimouski, Son Excellence Mgr C. E. Parent, collaborateur
de 1916 à 1920 à la rédaction, joint à ses vœux, dans ce numéro du
jubilé d’or, quelques propos sur l’éducation.
Mgr Lionel Roy, P. D. (1) , en évoquant le souvenir des fondateurs, des
officiers du Cercle St-Joseph de l’A. C. J. C (2) rappelle les débuts de
la valeureuse équipe : Georges Dionne (aujourd’hui Monseigneur, résidant
au Séminaire), Philippe Belzile, Alexandre Michaud, Alphonse St-Pierre
et … Alphonse Fortin. Le premier numéro sortit des presses … un jour de
congé accordé pour un jubilé d’or d’un prêtre de la maison, le chanoine
Normandin. Devise : parlons français ! (La croisade pour améliorer la
qualité de la langue parlée était d’actualité à cette époque même).
Format : 8 × 12 ¾ pouces. Six pages de texte serré. Abonnement : 0,10 $
par année. Publication hebdomadaire du jeudi.
On
y lit aussi les vœux du supérieur, Mgr Antoine Gagnon, P. D., et ses
hommages aux nombreuses générations d’écoliers qui alimentèrent ce
périodique étudiant, « vaillant petit journal qui a bien rempli son
rôle ».
À côté de l’article de Gérard Fillion, du Devoir, un autre
ancien, les glanures à travers les éditions de ce demi-siècle de la
Vie écolière nous apprennent que la première photographie parut le
27 février 1933, 22 ans après le premier numéro de l’an 1911. »
Le dernier numéro du journal étudiant a été publié le 13 mars 1967 après
57 ans d’existence. Il a été remplacé par
Le Scribe devenu le journal
des élèves du cégep de Rimouski.
* * * * *
(1) P. D. est un titre honorifique
de l’Église catholique romaine. Le porteur de ce titre
peut alors se faire
appeler monseigneur sans être pour autant consacré évêque. Ce titre est
généralement accordé à des personnes plus âgées qui occupent localement
une fonction hiérarchique dans la gouvernance de l’Église.
(2) l’A. C. J. C : Association catholique de la jeunesse canadienne. |
|
| Retour | Accueil |
|
#
5885
9 avril 2021
La tunique au Séminaire
Autrefois, dans les
collèges classiques, il était de tradition que les élèves portent un
costume règlementaire. Dans
Le livre de raison du Séminaire de
Rimouski publié en 1963, l’auteur l’abbé Armand Lamontagne
présente la tunique comme faisant partie du costume pendant de
nombreuses années. Voici ce qu’il a écrit :
« Jusque vers 1930,
l’habit à tout faire était le costume d’écolier. Un élève qui aurait
enlevé sa tunique à la cour (de récréation) aurait causé le même
scandale qu’un prêtre qui serait entré dans la salle académique sans sa
soutane. Le costume complet (et il devait être porté au complet)
comprenait la visière bleue en dehors et verte en dedans, qui campait
bien le genre de troupier auquel on avait affaire. (…)
Le costume comprenait
aussi la tunique qui devait se porter en bas des genoux. Les « nouvelle
vague » et les « sexés » profitaient des périodes d’accalmie pour
manquer aux règles les plus élémentaires de la modestie et la porter en
haut du genou. Le dessous de cette tunique, quand il n’était pas un
ensemble de pièces qui ressemblait d’assez près aux anciens couvre-pieds
de courte pointe, consistait en une culotte serrée ou de modèle « golf »
avec un bas dont à peu près trois pouces retombaient sous le genou,
par-dessus la jarretière.
Mais là où
s’exprimait le plus clairement la personnalité, c’était la façon de
porter la ceinture. Celle-ci était large ou mince, frangée ou non
frangée : c’était l’indice du contenu du porte-monnaie. Ceux qui
n’avaient pas besoin d’exprimer de révolte et savaient facilement se
soumettre aux lois portaient plutôt la queue en arrière. Les évaporés la
portaient en avant. Les rigides la serraient sur l’abdomen comme un
« cingulum castitatis » (ceinture de chasteté). Les laxistes la
détendaient et s’en servaient plutôt comme d’un manchon où ils pouvaient
se réchauffer les mains. (…)
Pendant les vacances, ce costume
devait être porté, les dimanches et jours de fêtes. » (Fin du texte
cité)
D’un collège à l’autre, l’uniforme pouvait être différent. Dans son roman de mœurs canadiennes intitulé Charles Guérin et daté de 1852, Pierre-J.-O. Chauveau écrit : Charles Guérin « portait, ainsi que son frère, le capot bleu aux nervures blanches, uniforme des élèves du Séminaire de Québec. » |
|
| Retour | Accueil |
|
#
5860
24 mars 2021
Purgation de masse
« Un mal qui répand
la terreur,
Dans
Le livre de raison du Séminaire de Rimouski publié en 1963, l’auteur
l’abbé Armand Lamontagne qualifie de purgation de masse les situations
où tous les élèves ou presque attrapaient la diarrhée. Il écrit :
« Les auteurs ne se sont jamais mis
d’accord pour décider s’il s’agissait d’un élément étranger qu’on
incorporait à la nourriture ou si, tout simplement, l’aliment contenait
en lui-même assez de force explosive pour révolutionner les humeurs. Un
fait reste certain, c’est que les élèves n’attendaient pas la décision
des savants pour être malades. C’était toujours le repas du soir qui
contenait l’élément hypocrite et le traître se glissait à l’intérieur de
la citadelle, non pas sous l’apparence du cheval de Troie, mais d’un
mets, jamais le même, et qui savait fouetter les appétits les plus
rébarbatifs. Je me rappelle qu’une fois ce furent des petits plats de
cretons qui, le lendemain, avaient attiré les soupçons de la plèbe,
alanguie et blême. (…)
Les premières plaintes fracassaient
« le silence d’une profonde nuit ». Réveillés par les premiers pèlerins,
les élèves, à qui le sommeil avait jusque-là caché la gravité de leur
mal, prenaient soudainement conscience de leur état et cherchaient eux
aussi à se débarrasser du ver rongeur. Mais l’architecte n’avait pas
prévu pareille affluence dans les débits du dortoir et les plaintes de
ceux qui attendaient se mêlaient à celles de ceux qui s’exécutaient.
Ceux qui revenaient, sentant leur fin prochaine, unissaient leurs jurements aux cris des rêveurs que le sommeil avait repris. Parfois ces équipées avaient des fins dramatiques, car, devant l’insistance de l’argumentation intérieure, le patient devait faire de n’importe quoi un gite à sa douleur. Et le lendemain matin, la troupe pâle quittait ce lieu de carnage et d’horreur. Je me rappelle qu’un matin un seul élève avait trouvé la force d’affronter le froid sec de février et de monter sur la glissoire. » (Fin du texte cité) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5825
3 mars 2021
Prospectus de 1876-1877
Dans l’édition du 30 août 1876, le
Courrier
du Canada
publie le prospectus du Séminaire de Rimouski pour l’année scolaire
1876-1877. Voici une partie de ce prospectus :
« Dans toute la maison offrant un développement de 425 pieds de longueur
sur 50 pieds de largeur règne un excellent système de ventilation, et
avant peu sera partout établi un appareil de chauffage à l’eau chaude et
l’éclairage
au gaz.
Deux bonnes bibliothèques sont à la disposition des élèves, l’une de 800
volumes pour ceux du Grand Séminaire, l’autre de 1500 volumes, pour ceux
du Petit Séminaire. Quatre prêtres au moins et douze ecclésiastiques
sont continuellement occupés soit aux classes, soit à la direction des
élèves.
Morale et discipline.
La morale et la discipline des élèves sont sous la surveillance
constante d’un directeur, prêtre et de plusieurs ecclésiastiques.
Tous sont tenus d’assister aux exercices religieux de la maison chaque
jour et aux offices de la cathédrale les dimanches et jours de fêtes.
Les élèves dont les parents demeurent dans la ville de Rimouski ont
seuls le privilège d’être externes. Tous les autres doivent être
pensionnaires.
Parloir
Les parents peuvent voir leurs enfants tous les jours de la semaine de
10 h à 10 ¼ h, de midi à une heure et de 4 h à 4 ½ h ; les jours de
congé toute la journée en été et l'après-midi seulement en hiver ; le
dimanche de midi à une heure et de 4 h à 4 ½ h. On ne permettra pas aux
élèves d'aller au parloir hors des heures
ici mentionnées.
Pension
Prix pour les pensionnaires : 80 $
Prix pour ceux qui couchent seulement : 20 $
Prix pour les externes : 15 $
La pension se paie d'avance en quatre termes égaux : à la rentrée, le 1er
novembre, le 1er février, 15 avril. On ne fait aucune
réduction pour une absence moindre que 6 semaines.
Prix pour abonnement du médecin : 1 $
Prix pour couverts au réfectoire : 0,25 $
Fournitures classiques.
Les élèves peuvent se procurer les livres, les cahiers, le papier, les
plumes, etc. dans la maison même et à de très bonnes conditions. Tous
ces effets doivent être payés comptant.
Déboursés facultatifs.
Lavage pour l'année : 5 $
Pour louage d'un lit y compris les couvertures : 5 $
Pour usage des livres à la bibliothèque : 1 $
Tout dommage causé aux effets de la maison, soit à la récréation, soit à l’étude, soit au réfectoire est aux frais de l’élève. Tout élève qui est à l’infirmerie doit payer 5 centins par jour en sus de la pension ordinaire. Les Sœurs de la Charité seront chargées de l’infirmerie dans le cas de maladie grave. » |
|
| Retour | Accueil |
|
#
5800
15 février
2021 Dix ans plus
tard
Quand le Séminaire de
Rimouski existait, les activités parascolaires constituaient un volet
important dans la formation des élèves et principalement chez les
pensionnaires. Nous avons comparé les parascolaires de 1953-1954 à ceux
de 1963-1964 à partir des annuaires de ces deux années. La liste des
parascolaires est divisée en trois parties : ceux qui ont cessé
d’exister, ceux qui ont survécu et ceux qui étaient nouveaux en
1963-1964.
1. Parascolaires qui existent en 1953-1954 et qui n’existent plus en
1963-1964 (7)
Académie Saint-Jean l’Évangéliste
1953-1954 Directeur :
L’abbé Ludger Rioux
Président : Yvonnik
St-Pierre
Association de la Jeunesse canadienne
1953-1954 Modérateur :
L’abbé Marcel Morin
Président : Jean-Gabriel
Bérubé (1er semestre) et Vianney Bérubé (2e
semestre)
Cercle Cardinal Mercier (philosophie)
1953-1954 Directeur :
L’abbé Pascal Parent
Cercle Langevin (Littérature)
1953-1954 Modérateur :
L’abbé André-Albert Gauvin
Président : Albert Lebel
Cercle Monseigneur Courchesne (patriotisme)
1953-1954 Modérateur :
L’abbé Marcel Morin
Président : Jean-Gabriel
Bérubé
Cercle Pie X (liturgie)
1953-1954 Directeur :
L’abbé Émile St-Pierre
Président : Jean de Dieu
Sénéchal
Magasin coopératif L’Estudiante (Grande Salle)
1953-1954 Gérant : Jean-Gabriel Bérubé
2. Parascolaires qui existent en 1953-1954 et qui existent encore en
1963-1964 (11)
Cercle missionnaire
1953-1954 Aumônier :
L’abbé Robert Michaud
Président : Jean-Louis
Chamberland
1963-1964 Aumônier :
L’abbé Robert Michaud
Président : Augustin
Bélanger
Ciné-club
1953-1954 Aumônier :
L’abbé François-Xavier Belzile
Président : Armand
Bélanger (1er semestre) et Bertrand Lepage (2e
semestre)
1963-1964 Moniteur :
L’abbé Jean-Yves Leblond
Président : Claude Gagnon
Congrégation mariale
1953-1954 Directeur :
L’abbé Raoul Thibault
Préfet : Raynald Brillant
1963-1964 Directeur :
L’abbé Raoul Thibault
Préfet : René Lagacé
Groupe scout du Séminaire
1953-1954 Aumônier : L’abbé Louis-Georges Lamontagne
Chef de troupe : Robert Rioux
1963-1964 Aumônier : L’abbé Louis-Georges Lamontagne
Chef de troupe : Lucien Roy
Harmonie Sainte-Cécile
1953-1954 Directeur : L’abbé Charles Morin
Président : Sarto Cloutier
1963-1964 Directeurs : Les abbés Charles Morin et
Euclide Ouellet
Président : Gilles Richard
Magasin coopératif La Collégiale (Petite Salle)
1953-1954 Gérant : Alban Bérubé
1963-1964 Responsables : Jean-Maurice D’Anjou, Gilles
Pelletier, Michel Ouellet
Mouvement Lacordaire
1953-1954 Aumônier :
L’abbé Pierre Bélanger
Président : Noël Gaudreau
1963-1944 Aumônier : L’abbé Roger Bérubé
Président : Ghislain Morneau
Orchestre Saint-Charles
1953-1954 Directeur : L’abbé Antoine Perrault
Président : Gilles Gagnon
1963-1964 Directeur : L’abbé Antoine Perrault
Président : Jean-Eudes Beaulieu
Société Saint-Pierre (sports)
1953-1954 Présidents chez les Grands : Jean-Guy
Mailloux (1er trimestre) et Desmond Paradis (2e
trimestre)
Président chez les Petits : Roch Archambault
1963-1964 Président chez les Grands : Pierre
St-Pierre
Responsables chez les Petits : André Lebel, Pierre
Fillion, Pierre Bérubé, Gérard Lord, Yvan Caillouette
Société Chorale
1953-1954 Directeur : L’abbé Norbert Roussel
Président : Jean-Gabriel Bérubé
1963-1964 Elle existe sous d’autres noms.
Vie écolière (La)
1953-1954 Moniteur : L’abbé Armand Lamontagne
Directeur : Jacques Roy
1963-1964 Conseiller : L’abbé Jean-Gabriel Bérubé
Directeur : Jacques Lagacé
3. Parascolaires qui n’existent pas en 1953-1954 et qui existent en
1963-1964 (6)
Chorale grégorienne
1963-1964 Directeur : L’abbé Paul-Émile Paré
(Pour ce parascolaire et les suivants, il n’y a pas
de comité pour l’administration)
Chorale polyphonique Grande chorale
1963-1964 Directeur : L’abbé Paul-Émile Paré
Chorale polyphonique Petite chorale
1963-1964 Directeur : L’abbé Paul-Émile Paré
Cinéma
1963-1964 Responsables : L’abbé Paul-Émile Paré,
Jean-Marc Charron, Claude Rouleau
Joyeux écoliers (Les)
1963-1964 Directeur : L’abbé Paul-Émile Paré
Théâtre
1963-1964 Responsables : L’abbé Paul-Émile Paré,
Lucien Lauzier, Rosaire Dumais
Bref, sept parascolaires qui existent en 1953-1954 n’existent plus en 1963-1964, onze parascolaires ont survécu et six parascolaires en 1963-1964 sont nouveaux par rapport à l’année 1953-1954. En 10 ans, c’est une transformation majeure. |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5765
24 janvier 2021
La Saint Thomas d'Aquin
Pendant de nombreuses
années, la Saint Thomas d'Aquin, inscrite au 7 mars dans l’ordo de
l’Église, a été fêtée notamment par les élèves de Philosophie
I du Séminaire de Rimouski.
Dans son édition du 23 mars 1883,
La Gazette des campagnes,
journal du cultivateur et du colon, publié à Kamouraska,
fait un compte-rendu de la dernière célébration à ce Séminaire.
« La fête de
l'Angélique docteur Saint Thomas d'Aquin, a été célébrée avec beaucoup
de pompe, mercredi dernier 7 mars, au Séminaire de Rimouski. Il va sans
dire que le jour de la fête du grand Saint que Léon XIII a donné pour
patron à toutes les écoles catholiques, est un grand congé
réglementaire.
À 9 h a. m., eut lieu,
à la chapelle du Séminaire, une grand'messe solennelle à laquelle
assistaient Sa Grandeur Mgr l'Évêque de Rimouski, ainsi que tout le
clergé de la ville, et les élèves du Grand et du Petit Séminaire. Le
sermon de circonstance fut prêché par M. le Grand Vicaire Edmond
Langevin, qui fit à Saint Thomas une heureuse application du texte :
« J'ai vu un ange dans le soleil » tiré de l'Apocalypse.
Le chœur des élèves
exécuta la messe du second ton harmonisée avec accompagnement
d'orchestre. Dans l'après-midi, MM. les élèves du Grand Séminaire nous
firent assister à une brillante joute scholastique. M. Ant. Bérubé
développa une thèse sur la nécessité du sacrement de pénitence.
Vigoureusement attaquée par MM. Soucy, Saindon, Sirois et Sylvain, elle
fut défendue avec beaucoup d'habileté par MM. Côté, D'Auteuil,
Belles-Isles et Roy.
A 7 ½
h p. m., MM. les élèves de philosophie junior nous donnèrent une
séance magnifiquement drapée de formes scholastiques. M. Sam. Rioux
développa la thèse du miracle. Elle eut pour adversaires, MM. A.
Morisset, J. Pelletier, T. D'Anjou et L. Bouillon, dont les objections
ne purent tenir en face des victorieux arguments de MM. A. Poirier, J.
Ouellet, J. Dubé, W. Cullen et Ad. Lavoie.
À la fin de chaque séance, Mgr l'Évêque de Rimouski félicita chaleureusement, en langue latine, les héros des brillants tournois théologiques et philosophiques dont il venait d'être témoin. Sa Grandeur paraissait heureux des honneurs prodigués à l'Ange de l’école par le Séminaire diocésain, sous la puissante impulsion de son supérieur, M. le chanoine L. J. Langis, docteur en théologie. » (Fin du texte cité) P. S. Après avoir
terminé cet article, j’ai appris que le 7 mars a été la date officielle
de la fête de Saint Thomas d’Aquin jusqu’en 1969. Depuis ce temps, la
date de la fête est le 28 janvier, jour de sa naissance au lieu du jour
de sa mort. |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5725
30 décembre 2020
À la recherche
d’un vaccin
J’ai composé ce récit intemporel dans
le but de vous souhaiter une année 2021 plus sympathique que celle en
cours. Bye bye 2020 et ne reviens plus. Que vos désirs se réalisent au
cours de cette nouvelle année.
Meilleurs vœux et portez-vous bien !
* * * * *
C’est la nuit du 28 au 29 décembre.
Damien a fêté un peu trop fort la veille. Il sommeille légèrement, se
réveille, se rendort : une roue qui tourne. Dans ce brouhaha, comme un
cauchemar, un costaud lui apparaît. Il a trois yeux et respire
profondément.
- Hop ! Damien. Je viens te chercher.
On retourne à la maison.
- Comment ça, de répondre Damien, je
suis chez moi.
- J’ai une mission pour toi, reprend le
Grand lutin. Déguédine.
Forcé d’obéir, Damien embarque dans une
navette spatiale qui a été construite par les ingénieurs du 98e
cours
du Séminaire de Rimouski. Sur le fronton, on peut lire : Navette 98. Le véhicule
passe par Saint-Mathieu-de-Rioux pour prendre Clovis et Rémi T. À
Saint-Fabien, c’est Paul-Émile qui est kidnappé. Aux abords de la
Gaspésie, c’est au tour de Raynald et de Jérôme. Tout le conseil de
classe du premier conventum du 98e cours.
Les six compères sont amenés au salon
du Pavillon de Philosophie. Qui est là ? Nul autre que Gilles Vigneault.
- Que faites-vous là, de dire en chœur
la bande des six ?
- Quand j’étais au Séminaire, je ne
pouvais pas aller à Natashquan chez mes parents à Noël. Je passais une
partie de mes journées dans ce salon à lire, à écrire et à écouter de la
musique. J’étais gâté par les prêtres. Depuis ce temps, je reviens
toujours ici pour fêter Noël.
- Et vous autres, que faites-vous ici ?
Je ne vous vois pas, mais je sens votre présence. Si Pascal Parent vous
voyait, il vous mettrait sur la liste noire.
- Nous avons une mission : découvrir un
nouveau vaccin pour la prochaine pandémie.
- Je l’ai découvert ce vaccin, de
reprendre Vigneault. Il y a plusieurs années, j’ai écrit : « Gens
du pays, c’est votre tour
de vous laisser parler d’amour. » Le
meilleur vaccin, c’est l’amour. L’abbé Georges Beaulieu, mon protecteur,
tenait le même discours.
Puis, Vigneault disparaît dans une lente mélodie inspirée de la danse à
Saint-Dilon. Pendant ce temps, à Saint-Mathieu, des parents sont
inquiets. L’oncle Léo trouve un livre où il est écrit « C. T. téléphone
maison » sur un signet. L’oncle Thomas fait à peu près la même
découverte. Sur le signet, on peut lire « R. T. téléphone maison ». Les
deux pères parlent au téléphone. Ils évoquent E. T., l’extraterrestre.
Ils trouvent cette disparition très mystérieuse.
- Pourquoi s’inquiéter, disent-ils à la fin, Clovis a 33 ans et Rémi 34
?
Légèrement apeurés, les six confrères commencent à discuter. On ne
s’entend pas, on parle fort, on crie, on hurle, on s’énerve, on frappe
sur les murs, on se lance des invectives. Bref, personne n’est au
naturel. Les discussions tournent en rond et s’éternisent.
Il faut bien se sustenter. Au restaurant, il n’en est pas question. Les
cartes de débit ou de crédit n’existent pas. Au réfectoire des prêtres,
c’est une bonne idée. Personne n’a peur de se faire prendre car ils ne
peuvent pas être vus par des étrangers.
Au bout de deux jours, sœur Charron la cuisinière en chef va voir
l’économe l’abbé Léo Lebel. Elle ne comprend pas comment il se fait que
les mets apprêtés sont insuffisants pour la douzaine de prêtres qui
demeurent au Séminaire. Le perspicace Léo Lebel engage l’inspecteur
Maigret pour faire enquête. Après quelques heures d’interrogatoire,
l’inspecteur remet son rapport : Extra-terrestres. Le grand Léo enrage.
« Cent dollars pour un mot. Il va falloir couper dans les bananes au
retour des Fêtes ».
Finalement, le troisième jour un peu avant minuit, les six compères font
semblant de s’entendre. « Il faudrait d’abord un virus pour découvrir un
vaccin, disent-ils en chœur ». À ce moment, toutes les lumières du
Pavillon de Philosophie s’éteignent. Des vents violents entrent par les
fenêtres. Une pluie d’eau salée fouette les visages. Les chaises
tournoient dans les airs. Dans une accalmie, on entend la voix de Pascal
Parent : « Bonne et heureuse année, les chatons. Grâce aux microphones
que j’avais fait installer, j’ai écouté vos conversations. J’ai reconnu
vos voix ».
Tout revient au calme. Le Grand lutin ramène chacun chez lui. Il semble
bien qu’aucun dégât majeur n’en résulte. Toutefois, au retour des
vacances, les étudiants remarquent sur le siège de six chaises les
initiales des voyageurs spatiaux. On fait une vente sur eBay à l’insu
des autorités. L’argent recueilli sert à faire un party pascal en
navette à Natashquan, incluant alcool et marijuana. FIN |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5685
6 décembre 2020
Bénédiction du deuxième Séminaire
Dans son
édition de juin 1876, le
Journal de l’instruction publique,
écrit que la
bénédiction du deuxième Séminaire de Rimouski devait avoir lieu le 4 novembre 1875. Toutefois, puisque les travaux n’étaient pas suffisamment
avancés, disait-on, et pour d’autres raisons obscures, cette
cérémonie a été retardée.
Cette décision fut mal reçue
autant chez les élèves
que chez les
professeurs.
Le
Journal dans son édition de juin 1876 fait un compte-rendu très positif de cette cérémonie.
« Mercredi, le 31 mai, a eu lieu
dans la ville de St-Germain de Rimouski la bénédiction du nouveau
Séminaire. La fête a été des plus imposantes et des plus solennelles.
Les évêques de la province
s’étaient rendus à Rimouski pour la circonstance, et ils ont
été l'objet de batteuses
démonstrations le long de la route et à leur arrivée.
Mgr Racine a été le
prédicateur du jour. Dans un sermon éloquent, l’évêque de Sherbrooke a
retracé les progrès des maisons d’éducation dans le pays, les bienfaits
de l’éducation fondée sur la religion, a décerné de justes éloges aux
fondateurs et bienfaiteurs de la maison, MM. les abbés Tanguay et
Potvin, et a félicité Mgr Langevin d’avoir mené à bonne fin la belle
œuvre d’un Séminaire.
Mgr Fabre a officié. Après la messe, grande procession jusqu’au
Séminaire et bénédiction solennelle de cette maison par Mgr l’archevêque
de Québec.
Immédiatement après cette cérémonie, eut lieu la présentation des
adresses de circonstance aux évêques réunis. Mgr Moreau répondit à celle
des élèves du collège ; Mgr l’archevêque répondit à celle du clergé de
Rimouski, présentée par M. le grand vicaire Langevin ; Mgr Laflèche
répondit à celle des citoyens, présentée par M. J. T. Couillard, maire
de Rimouski.
La cérémonie finie, il y eut grand
dîner au Séminaire.
La fête s'est terminée par une soirée littéraire et musicale fort brillante dans la grande salle du nouveau collège, et par un feu d’artifice sur la place publique. Dans cette séance littéraire, des discours ont été prononcés par Mgr Langevin, l’honorable M. Ouimet, surintendant de l’instruction publique, MM. Bérubé, Letendre et Derome. » (Fin du texte cité) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5650
15 novembre 2020
Point de vue d’un
externe
Sous le titre Regrettable,
autrefois
et aujourd’hui, dans son édition du 25 octobre 1912, le
Progrès du Golfe
publie la lettre d’un ancien
élève
externe du Séminaire
de Rimouski. Ce texte est signé Cyprien Larue. Voici quelques
extraits
de cette
lettre
:
« L'un des derniers numéros
de La Vie Écolière nous
apprenait que cette année, au Séminaire de Rimouski, les grands élèves
sont séparés des petits ; que ces derniers « occupent l’ancienne cour
des externes », qu’ils ont de même « hérité de leur étude et de leur
salle de récréation ».
Que les grands élèves soient séparés des petits - il s’agit ici des
pensionnaires - cela nous importe peu, et c'est l’affaire de MM. les
directeurs des écoliers. Mais ce qui nous intéresse vivement et,
ajoutons-le, ce que nous regrettons amèrement c’est le fait que, sous le
prétexte plus ou moins
plausible d’opérer une réforme favorable aux élèves du pensionnat, les
collégiens de Rimouski, externes suivant une coutume qui ne date pas
d’hier, sont dépossédés de leur cour, de leurs salles d’études et de
récréations ; qu’ils n’ont plus droit que d’assister tout juste aux
leçons des professeurs durant les heures de classe. Ils vont aussi à la
messe, mais c’est tout. Ils n’ont plus pratiquement aucun règlement
disciplinaire à observer. Allant en classe quatre heures par jour, nos
externes jouissent de leur liberté pendant les heures réglementaires
d’étude et le reste du jour. »
Suit un long réquisitoire dans lequel l’auteur mentionne qu’il
n’est pas facile pour les chefs de famille de surveiller leurs enfants
et il voudrait que les professeurs du Séminaire continuent à jouer ce
rôle. Il allègue que la discipline est un excellent moyen de formation.
Il continue :
« On nous disait que pour devenir des hommes de caractère et de
volonté, des citoyens honnêtes et consciencieux, des chrétiens
intrépides et fidèles à nos devoirs, il fallait obéir aux commandements
de nos directeurs, observer scrupuleusement le « règlement » dans ses
moindres détails. Or, il était ordonné aux élèves externes de mon temps
- il n’y a pas de cela un demi-siècle - d'arriver le matin à la cour dix
minutes avant l’heure de la messe, une demi-heure avant l’étude
d’après-midi ; nous avions 25 minutes - pas plus - à 4 h p.m. pour aller
prendre une légère collation avant l’étude du soir. Le tout sous peine
de pensums, de fessées, de "retenue” pendant les congés. Beau ou mauvais
temps en toutes saisons, il fallait assister à l’étude du soir. Et même
pour ceux qui demeuraient à 3 ou 4 milles de l’institution, ce n’était
pas toujours facile d’obtenir qu'ils fussent exemptés de l’étude. La
règle ! Voyez-vous.
Le dimanche, nous étions strictement tenus d’assister à deux
messes, la grande et la basse, d’aller au catéchisme et aux vêpres, aux
études de l’avant-midi et du soir. Il fallait sous peine d’expulsion
communier au moins une fois le mois.
En
outre, il était formellement interdit à tout externe, grand et petit, -
l’œil du directeur nous poursuivait partout - de sortir de nos maisons
après 8 h du soir, d’aller sans raison grave à la gare "voir passer les
chars” ou "faire un tour avec la malle anglaise". Malheur à ceux qui, en
rupture de règlement, étaient rencontrés le soir par les « spotters » du
Séminaire, pour me servir d’une expression fashionable. Gare au
lendemain !
Enfin, je pourrais citer une foule d’ordonnances et de petites prohibitions auxquelles nous étions astreints, et tout cela … pour nous former, pour discipliner nos jeunes volontés indociles et rebelles, pour nous habituer à respecter les Autorités, pour faire de nous des hommes de caractère et de devoir ! C’était la raison d’être du règlement et des châtiments dont on frappait ceux qui lui étaient infidèles. (…) » (Fin du texte cité) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5620
27 octobre 2020
La fête de saint Thomas d’Aquin
Dans son édition du 13 mars 1882, le
Courrier du Canada, un journal
de Québec, décrit le déroulement de la saint Thomas d’Aquin au Séminaire
de Rimouski cette année-là.
« Le 7
mars est toujours une fête pour les élèves et les professeurs de cette
maison, depuis surtout la publication de l’Encyclique
Æterni
Patris et la qualité de patron de toutes les
écoles catholiques que Léon XIII a décernée au Docteur Angélique.
La
solennité a naturellement commencé par la messe que Mgr de Rimouski a
bien voulu célébrer lui-même dans la chapelle où tous étaient réunis ;
après la messe, Sa Grandeur a proposé aux élèves l’imitation des vertus
de l'illustre saint, dont la gloire s’étend de plus en plus, et leur a
rappelé les sentiments de piété éminente qu’il montra toute sa vie
envers la sainte Eucharistie, l’image de Jésus crucifié et de sa sainte
mère, la vierge immaculée.
Pour
célébrer le jour aussi bien qu’ils le pouvaient, les élèves de
philosophie se réunirent dans la salle principale, vers 9 heures, et se
livrèrent un assaut en règle, en observant toutes les formes de la
dialectique.
L’un
d’entre eux, M. Martin exposa d’abord sa thèse sur l’immortalité de
l’âme ; et ses confrères attaquèrent et défendirent alternativement les
arguments qui avaient été apportés à l’appui de cette grande vérité.
Leur succès dans cette joute pacifique, soutenue de part et d’autre dans
la langue de l’école, leur mérita les félicitations de Mgr l’Évêque, si
empressé à encourager les fortes études.
Sur le
soir, MM. les séminaristes (étudiants du Grand Séminaire) de leur côté
prirent pour thème de leur discussion la sainte Eucharistie, dont la
louange occupe une si large part dans les travaux de saint Thomas. La
thèse de la présence réelle de Notre Seigneur fut très habilement
exposée par M. Bélanger, qui invita ses confrères à présenter des
objections et à les combattre à la manière du prince des théologiens,
afin de faire ressortir encore davantage les preuves irréfragables du
dogme fondamental par lequel Notre Sauveur nous a prouvé son amour sans
bornes.
Après
deux heures de la discussion la plus animée et conduite avec bonheur,
MM. les théologiens s’attirèrent une apostrophe flatteuse, exprimée dans
la langue qu’ils avaient employée ; Mgr leur décerna des compliments
mérités, et rapprochant la thèse de l’Immortalité de l’Âme de celle de
la présence réelle dans l’Eucharistie, il a rappelé que cette nourriture
céleste donne au corps le germe de la résurrection et à l’Âme le
commencement de la vie éternelle. (…)
Sur l’invitation de Sa Grandeur, toutes les personnes présentes se sont transportées à la chapelle, et un salut solennel été chanté pour couronner dignement une journée consacrée au souvenir du poète de l’Eucharistie. » (Fin du texte cité) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5585
6 octobre 2020
Plans du deuxième
Séminaire
Dans son
édition du 30 janvier 1871, le journal
Le
Courrier du Canada nous renseigne sur les plans du
deuxième Séminaire de Rimouski.
« Nous avons vu ces jours derniers les plans du vaste édifice que
Mgr Langevin fait ériger à St-Germain de Rimouski pour servir de grand
et de petit Séminaire.
Nous croyons pouvoir affirmer que cette nouvelle construction
égalera en grandeur et en beauté tout ce que nous avons de mieux en ce
pays. Quoique l’on ne vienne seulement que d’en jeter les bases, nous
sommes certain que le Séminaire sera bientôt achevé, connaissant bien
l’esprit d’entreprise de Mgr de Rimouski et le zèle de ses diocésains.
Les bâtiments auront 398 pieds de long sur 54 avec les ailes, 256 de
façade à 4 étages avec toit français.
Les plans, œuvre
d’un enfant même de la paroisse
de Rimouski, M. Thomas Jacob Lepage, architecte de cette ville, sont
vraiment magnifiques. Il est bien difficile d’exécuter un plan aussi
bien et avec autant de goût. Une esquisse en perspective est vraiment
étonnante de vérité et dénote chez son auteur une grande science
d’architecture et de dessin. M. Lepage ne fait que débuter dans sa
carrière d’architecte, mais ses premiers débuts lui donnent droit à de
grandes espérances que doivent lui assurer, en outre, son talent
incontesté et sa rare
persévérance
au travail. »
Plus tard,
dans une lettre pastorale du
18 décembre 1872, Mgr Jean Langevin écrit : « Maintenant, Nos Chers
Frères, nous avons la douce confiance que vous ne laisserez pas votre
ardeur se ralentir. Ceux qui ont eu l'occasion de venir à Rimouski ont
pu se convaincre par leurs propres yeux de l'étendue et de la solidité
des ouvrages commencés. Les murs sont élevés au-dessus des fenêtres du
premier étage, dans une moitié environ de la bâtisse ; et dans l'autre
moitié ils sont sortis de terre.
Cet hiver, on continue à tirer et à préparer la
pierre dans la carrière, et le bois dans la forêt ; bientôt on aura
besoin de nouvelles corvées pour charroyer ces matériaux, ainsi que la
brique. Il faudrait absolument ouvrir au moins une aile, sinon la moitié
de l'édifice l'automne prochain.
Vous comprenez facilement, N. C. F. (nos chers frères), quelle masse de pierre, de brique, de chaux, de bois de toute espèce, exige un édifice de près de 250 pieds de front, deux ailes de 100 pieds chacune, sur 50 de largeur, à trois étages, avec des caves où l'on entre en voiture. Chaque semaine, le prêtre qui se dévoue à cette besogne, ne paye pas moins de 100 $ à 150 $ pour la main d'œuvre et les matériaux. » (Ce dernier extrait a été publié sur le site du Séminaire de Rimouski.) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5555
18 septembre 2020
Trousseau des élèves en 1876
Dans son édition du 30 août 1876, le
Courrier
du Canada publie des extraits du prospectus du Séminaire de
Rimouski. Voici ce qu’on écrit au sujet du trousseau des élèves :
« Costume - Il consiste en
un capot de drap bleu avec nervures blanches, descendant plus bas que le
genou, d'une ceinture en laine verte, pantalon noir, d’une cravate noire
avec chemise blanche faite suivant le modèle qui sera fourni par le
Directeur. En hiver, on ajoute une bande d’astrakan ou de mouton à la
casquette d’été.
De
plus, chaque élève devra être pourvu des effets suivants :
- Une
couchette en fer ou en bois avec un sommier à ressort ou piqué,
- Un
matelas et deux oreillers,
- Une
valise, coffre ou autre buffet pour mettre son linge,
- 2
paires de draps de lit,
- Autres couvertures à son gré,
- 4 taies d'oreiller,
- 6 serviettes de table,
- 4 chemises au moins,
- 3 camisoles,
- 6 serviettes de toilette,
- 2 paires de pantalons,
- 1 douzaine de mouchoirs,
- 2 cravates,
- 1 paire de caoutchouc (bottes),
- 1 parapluie,
- 3 paires de caleçons,
- 1 douzaine de collets,
- 6 paires de bas,
- 2 robes et bonnets de nuit,
- 2 paires de chaussures au moins,
- Peignes, brosses pour les dents, les cheveux,
les hardes, les chaussures, gobelet, savon,
- 2 sacs au linge sale,
- Pour l’hiver, 1 pardessus, un cache-nez ou
crémone, 1 paire de mitaines ou gants.
Pour le réfectoire, chaque élève devra fournir
son couteau, sa fourchette, ses cuillers et son gobelet. Le Séminaire ne
fournira que les assiettes et la tasse à thé.
On ne
permettra les chaussures à hautes jambes et les chaussures à semelles
ferrées que dans la cour, et jamais à l'intérieur.
Les
parents pourront ajouter tels effets qu'ils voudront à ceux qui sont ici
mentionnés. Aucun élève ne sera admis sans avoir au moins tous ces
effets. Un maître examinera la valise de chacun à son entrée. Tous ces
objets devront être marqués lisiblement au nom de l'élève : sinon on les
fera marquer à ses frais après son arrivée. » (Fin du texte cité dont
l’ordre a été légèrement remanié)
Imaginez la
scène du père de famille qui va reconduire son fils pensionnaire au
Séminaire dans une voiture tirée par un bœuf ou par un cheval. En 1876,
le train intercolonial Rivière-du-Loup/Nouveau-Brunswick vient à peine
d’être inauguré.
Que voit-on principalement dans la voiture ? Les deux personnages, le lit avec matelas, la valise et peut-être des produits de la ferme comme du bois de chauffage, une caisse de livres de beurre, des poches de pommes de terre, une caisse d’œufs, des p’tits cochons, des poules, etc. Cette façon de payer la pension était encouragée car l’argent circulait peu. |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5520
27 août 2020
Un fossile au Séminaire
Le Journal de l’instruction
publique, dans son édition de novembre 1869, nous apprend qu’un
fossile a été trouvé à Bic en 1869 et que ce fossile a été donné au
musée du Séminaire de Rimouski. Le titre de l’article que voici est
Fossile animal.
« Dans le cours des excavations qui se poursuivaient au Bic, sur le
tracé du chemin de fer, la pioche des travailleurs mit dernièrement à
jour le squelette entier d’un animal marin mesurant
13 pieds de longueur. Enfoui dans le sous-sol à 14 pieds de
profondeur, le fossile était enveloppé dans une argile extrêmement dure,
et l’on ne parvint pas sans peine à le désagréger complètement. Malgré
la désarticulation des ossements résultée de cette opération première,
il ne sera pas difficile de reposer le squelette et de lui redonner sa
forme intégrale.
Des personnes que cette découverte intéressait ont cru voir dans ces
restes les os de quelque poisson dont la tête, pourvue de deux canines
ou défenses à la mâchoire supérieure, démontre assez que le sujet dont
nous parlons appartient à la famille des
vaches marines appelées
morses par les naturalistes. Moins la grandeur de la taille et le pelage
rousse, ces animaux ont beaucoup de ressemblance avec les phoques
(loups-marins) si communs dans les eaux du golfe.
Quant à celui qui nous occupe, la dépouille en a été retrouvée dans un
fonds avoisinant la propriété de M. Georges Sylvain. On se demande par
suite de quelle révolution sous-marine ou terrestre, cet individu de
l’une des nombreuses espèces qui peuplent les mers du Nord se
retrouve-t-il, si loin de ses eaux natales, à cette profondeur de 13
pieds et demi sous terre, à distance assez considérable des bords du
Saint-Laurent, qu’une montagne élevée sépare du lieu où ses ossements
gisaient ? Est-ce là un débris antédiluvien ? Serait-ce plutôt un
visiteur inattendu de la mer glaciale, s’égarant dans notre fleuve au
moment où survenait le cataclysme de 1653 ?
Bien que nous jugions le problème digne de toute l’attention des
archéologues, nous devons cependant en abandonner la solution à
d’autres. D’ailleurs les amis de la science auront plus d’une fois, s’il
leur en tient l’occasion, d’examiner ce fossile remarquable, puisque M.
le grand-vicaire de ce diocèse en a fait l’acquisition dans la vue
tout-à-fait libérale de donner au morse squelette une place d’honneur
dans le musée du Séminaire de Rimouski. (Voix du Golfe) » (Fin du texte
cité)
Un autre fossile de morse avait été trouvé à Rimouski en 1853. C’est ce
que raconte l’abbé Charles Guay en 1873 dans
Chronique de Rimouski, volume
1 :
« Le fossile d’un morse a été découvert en 1853, à 200 pieds au-dessus du niveau du Saint-Laurent, et à trois lieux dans l’intérieur de Rimouski, et faisait partie du musée de M. l’abbé Tanguay, qui en a fait cadeau à l’Université Laval. » |
|
| Retour | Accueil |
| Suite des textes sur le Séminaire de Rimouski | |
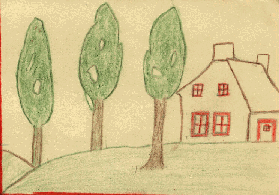
 Le
5 avril 1881, le séminaire fut incendié. Et on retourna pour une
année dans la vieille église que les Sœurs des Petites écoles
habitaient depuis 1876, et qui durent quitter la place. En mai 1828,
fut conclu l'achat du couvent des Dames de la Congrégation. Il
fallut compléter et aménager le nouveau local qui fut ouvert aux
élèves dès le mois de septembre.
Le
5 avril 1881, le séminaire fut incendié. Et on retourna pour une
année dans la vieille église que les Sœurs des Petites écoles
habitaient depuis 1876, et qui durent quitter la place. En mai 1828,
fut conclu l'achat du couvent des Dames de la Congrégation. Il
fallut compléter et aménager le nouveau local qui fut ouvert aux
élèves dès le mois de septembre. 
 À
partir du début de la décennie 1960, des changements importants sont
apportés à la structure même de l’institution. De plus en plus, les
élèves sentent le besoin d’avoir leur mot à dire. C’est dans ce contexte
que naît une association d’étudiants du Séminaire en 1964.
À
partir du début de la décennie 1960, des changements importants sont
apportés à la structure même de l’institution. De plus en plus, les
élèves sentent le besoin d’avoir leur mot à dire. C’est dans ce contexte
que naît une association d’étudiants du Séminaire en 1964. 